Haïku
Une filet de lumière
Des eaux stagnantes
L'espoir renaît ____
Le regard fixe
Le coeur alerte
L'immensité __
Les souvenirs s'essouflent
Le futur s'estompe
L'intensité d'être _______

Une filet de lumière
Des eaux stagnantes
L'espoir renaît ____
Le regard fixe
Le coeur alerte
L'immensité __
Les souvenirs s'essouflent
Le futur s'estompe
L'intensité d'être _______

[1er mars 1897]
Louis de Saint-Jacques
J'estime très haut M. Gide ; il est un des nouveaux venus de qui l'on est en droit d'attendre de belles réalisations, et déjà il nous donna un peu plus que des promesses : le Voyage d'Urien et Paludes nous montrèrent chez lui cette anxiété si intéressante du jeune homme qui cherche sa voie, angoisse que tous nous ressentîmes quand, après en avoir délibéré avec nous-mêmes, nous résolûmes d'entrer dans la vie. Il me semble que dans son volume, M. Gide nous livre au moins une part de ses propres délibérations, le problème vital l'attire, et, s'il n'arrive pas encore à en trouver la solution complète, ses efforts n'en demeurent que plus louables parce qu'ils furent persévérants. Ce faisant, plus que bien d'autres, il fit vraiment oeuvre d'art. En effet, Schopenhauer le remarque avec justesse (1) : « Le résultat de toute conception purement objective, donc aussi de toute conception artistique des choses, est une nouvelle expression de l'essence de la vie, une nouvelle réponse a cette demande : qu'est-ce que l’existence ? — Chaque véritable œuvre d'art bien réussie répond à cette question à sa manière et toujours juste... Son but propre est de nous montrer la vie et les choses telles qu'elles sont réellement; seulement, dans la réalité, elles ne peuvent être comprises par tout le monde, parce qu'une foule de conditions accidentelles, objectives et subjectives viennent les voiler. C'est ce voile que l'art écarte. » M. Gide n'a pas écarté le voile; mais, et c'est là son éloge, il s'y est essayé. Et, certes, il n'avait pas besoin de nous expliquer sa tentative à l'aide de cette préface qu'il a pris la peine d'écrire en rééditant les aventures d'Urien. Le livre lu, on découvre aisément soi-même l’émotion qu'il représente et que l'auteur résume très bien du reste en une seule phrase qu'il est bon de citer : cette émotion « n'est point une émotion particulière; c'est celle même que nous donna le rêve de la vie, depuis la naissance étonnée jusqu'à la mort non convaincue; et mes marins sans caractères tour à tour deviennent ou l'humanité tout entière ou se réduisent à moi-même. » Cette conception, si je ne me trompe, dérive strictement de celle de Schopenhauer que nous venons de transcrire. Mais cette coïncidence, pour être curieuse, n'est pas étonnante : M. Gide a du goût pour les idées générales, il n'est donc pas extraordinaire qu'à l'occasion de l’une d'entre elles, il se rencontre précisément avec un des philosophes modernes qui les ont le plus aimées.
De cette rare qualité d'esprit qui pousse M. Gide à se préoccuper avec passion de pure métaphysique, il résulte une autre conséquence plus grave qui doit lui être reprochée : il oublie que les conditions de l'œuvre d'art ne doivent pas être les mêmes que celles de l'œuvre philosophique, et, perdant l'exacte notion de ces différences essentielles, il arrive qu'il n'en tient plus compte : il abstrait trop. Bien qu'ils agissent et qu'ils voyagent, Urien et ses compagnons ne vivent pas. Aucun signe distinctif ne les sépare les uns des autres. Leurs discours ne sont d'ordinaire que des jeux de rhétorique. On sent toujours que M. Gide demeure le mécanicien qui fait mouvoir leurs rouages, ils ne sortent jamais de leurs attitudes de marionnettes. Et, privés d'une âme qui leur appartienne, ils ne peuvent pas nous retenir. Quant aux décors qui les entourent, à part ceux de la mer Glaciale, ils nous laissent tout aussi froids. La course errante à travers l'océan Pathétique se prolonge mortellement d'une île imaginaire à une ville irréelle, d'une ville illusoire à une île qui n'est pas. La dérive sur la mer des Sargasses s'accomplit de même sorte. Seule, la marche vers le pôle parvient à se dramatiser. Le tort de ces explorations diverses, c'est qu'elles accusent trop l'emploi du même procédé, la description du paysage symbolique, c'est-à-dire du site qui n'existe pas. L'ouvrage de M. Gide ne contient pas, en effet, autre chose qu'une série de tableaux dont tous les éléments sont bien empruntés à la nature, mais dont l'aspect rigide et morne nous révèle qu'ils ne sont pas vécus : il me plairait de les nommer des tableaux métaphysiques. Le principe sur lequel l'auteur s'est appuyé pour les construire mérite par son originalité qu'on lui prête quelque attention. « Il semble juste » à M. Gide « qu'une émotion que donne un paysage puisse se resservir de lui — comme d'un mot — et s'y reverser tout entière, puisqu'elle en fut à l'origine enveloppée... Le manifeste vaut l’émotion intégralement...; émotion et manifeste forment équation ; l'un est l'équivalent de l'autre. Qui dit émotion dira donc paysage ; et qui lit paysage devra donc connaître émotion. Une émotion naît... non, elle est. Elle est depuis aussi longtemps que toutes choses qui la manifestent.... sa vie est le besoin même de se manifester... C'est l'émotion qui choisit elle-même son manifeste. Cette fois elle choisit le paysage.— pourquoi ? parce que pourquoi ne l'avait-on pas déjà choisi ? » — Ainsi l'émotion serait indépendante de nous, elle serait « issue de Dieu », « sa mort serait impossible », par suite elle serait éternelle, ce serait une véritable entité. Et non pas une entité morte, mais une entité douée d'une activité sans terme, vivante et se manifestant sans cesse au gré de cette même activité. M. Gide a-t-il bâti cette théorie pour expliquer son livre, ou bien a-t-il écrit son livre pour confirmer cette théorie? Que l'on prenne l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, peu importe, le paradoxe qu'il présente est ingénieux, mais il n'est guère soutenable. Pour lui donner une apparence de raison, M. Gide a dû tourner une difficulté sérieuse : il a fallu qu'il évitât de nous définir exactement ce qu'il entendait par le mot émotion. Il espérait ainsi, sans éveiller notre attention, donner librement carrière à son penchant pour la métaphysique, en douant l'émotion, phénomène tout subjectif, d'un être que, par elle-même, il lui est impossible d'avoir ; car il n'y a d'émotion que là où il y a un sujet connaissant. Si moi, sujet connaissant, je considère un paysage, ce paysage, la chose est sûre, me fournira une émotion. Mais cette émotion n'était pas contenue dans le paysage elle n'était pas en dehors de lui, non plus. Cette émotion n'existait pas avant que je me fusse représenté le paysage. Simplement elle est née en moi à la suite de cette représentation, et sitôt que j'en eus connaissance, elle se transforma en notion. Mais émotion, notion ou représentation, tout cela dépend de moi-même, et tout cela, sans moi, n'existerait pas. Toutes ces choses ne sont que des modes de mon activité intellectuelle; elles sont en moi et pour moi des manifestations de mon moi, elles n'ont rien de fixe qui leur soit propre, et toutes varieront à mesure que le moi qui les conditionne variera. C'est pourquoi il n'est pas vrai de dire que « le manifeste vaut l'émotion intégralement ». Le même paysage ne donne jamais la même émotion, car pour qu'il y ait une émotion, il faut que je regarde le paysage ; et suivant l'état d'esprit dans lequel je me trouverai, ou le degré de sensibilité qui sera le mien au moment où je l'aurai en ma présence, étant d'ailleurs supposé que rien ne change dans le paysage, mon émotion revêtira les formes les plus diverses : le paysage ne sera que l'occasion d'une émotion dont je suis l'acteur. L’émotion est le résultat de cette rencontre de mon moi avec le paysage. Par suite, elle ne se reproduira intégralement et identiquement qu'à cette double condition : que le paysage ni moi, nous n'ayons varié, et que la rencontre de mon moi avec le paysage s'effectue toujours de la même façon.
On ne peut, sur une erreur, échafauder une œuvre parfaite; qu'elle se produise en art ou en philosophie, elle empêche une édification solide, de même qu'en mathématiques elle ruine tous les calculs. Le Voyage d'Urien est la meilleure des preuves que, malgré son incontestable talent et ses belles qualités de style, M. Gide a échoué dans son essai de démonstration pratique du théorème faux qu'il avait formulé. Il voulut en faire l'application à « cette émotion même que nous donna, le rêve de vie, depuis la naissance étonnée jusqu'à la mort non convaincue ». Il tenta de l'exprimer par des paysages, au lieu d'en animer Urien et ses compagnons d'infortune. Il eut enfin cette ambition de réaliser dans ses marins tour à tour l'humanité entière ou sa propre conscience. Mais cette émotion devant la vie, il ne pouvait fatalement la concevoir que sous la forme particulière qu'elle prenait dans son intelligence. Et comme nécessairement encore cette émotion, ou plutôt cette notion, était abstraite, en la réduisant en paysages, il ne créait que des paysages abstraits. Ils sont abstraits, par suite ils ne sont point dans la nature; composés en vertu d'un artifice, ils sont tout artificiels. Ainsi, quand M. Gide voulut dépeindre l'ennui de vivre, il mena ses tristes errants sur la mer grise des Sargasses, parce que, pour lui, ce manifeste valait cette émotion intégralement. Mais si, pour moi, cet ennui est plutôt le désert Arabique, ou la Champagne crayeuse, ou les immenses solitudes de la Sibérie désolée, la mer des Sargasses ne m'évoquera pas l'ennui de vivre, je ne m'intéresserai qu'au décor extérieur, c'est-à-dire à la mer des Sargasses en tant que mer des Sargasses, et j'exigerai de M. Gide qu'il m'en donne une description fidèle comme s'il y était allé. Or on voit trop qu'il n'y est pas allé. On voit aussi qu'il est gêné de son procédé même : il ne sait trop comment sortir de son océan Pathétique, puisque, en réalité, il n'y a aucune raison pour qu'il en sorte, la série des tableaux pouvant être indéfinie; et quand il gagne le pôle, on s'aperçoit tout au contraire qu'il est proche du terme, tant la hâte de finir se révèle sous les mots. Car le style de M. Gide est un style singulier. Non pas que j'attache à cette épithète un sens péjoratif ou une signification désobligeante ; bien loin de là, je considère qu'en le qualifiant ainsi, je lui décerne un grand éloge : nous devons tous nous efforcer d'avoir un style qui soit le nôtre et pas celui d'un autre, et c'est pour avoir acquis ce mérite que celui de M. Gide est en tout point singulier. J'en connais peu où les mots vivent d'une vie plus intense. Ils se construisent en phrases bouillantes de passion contenue : ils se renforcent en s'assemblant. Je tiens que ce don n'est pas ordinaire. Et je suppose qu'il provient sans doute du tempérament nerveux de l'écrivain. Grâce à lui, le voyage d'Urien se colore d'une certaine vie : sous la froideur des paysages, des crispations et des exaltations se montrent; ce sont, quoi qu'il en dise, celles-là même de M. Gide, ou c'est du moins parce que nous voyons que ce sont elles que nous nous intéressons à ce livre, et qu'il nous plaît, malgré l'erreur capitale qui présida à sa composition.
La nervosité que laisse percer Urien se déploie tout à son aise dans Paludes, fantaisie en six chapitres étiquetés chacun d'un jour de la semaine, suivis d'une table des phrases les plus remarquables et clôturés par une postface qui ne figurait pas dans l'édition originale. Cette postface répond à la dédicace légèrement pince-sans-rire « Pour mon ami Eugène Rouard j'écrivis cette satire de quoi ? » Nous y trouvons cette confidence que le livre fut écrit par un jeune homme passionné, après un an de maladie et de voyage au pays de la lumière, loin de notre civilisation absurde et selon ce plein optimisme que procure la convalescence. Il fut écrit comme un soulagement, pour rire ; comme une préface, pour annoncer le prochain volume de M. Gide à paraître sous ce titre : les Nourritures terrestres ; comme une satire enfin de « ces hommes du Nord qui croient toujours qu’au-dessus du bien se pourrait obtenir quelque mieux préférable ».
Comment Paludes ou le traité de la contingence annonce-t-il les futures Nourritures terrestres ? je ne saurais préjuger. Mais que l'auteur ait voulu rire, je n'en disconviens pas. Qui plus est, j'avoue que son rire me semble influencé par cette longue maladie qui lui fut antérieure, de telle sorte qu'il est parfois morbide et grimace au lieu de s'épanouir. Je reconnais que M. Gide a dû énormément s'amuser tandis qu'il travaillait à son livre, je regrette qu'il n'ait pas eu pitié de ses lecteurs submergés à la fin sous les flots de son ironie. Ils en furent si affectés que, paraît-il, ils ne comprirent rien à Paludes puisqu'une postface devint utile pour le leur expliquer : c'est du moins ce que prétend M. Gide, et j'ai peur, à ce point de vue, qu'il ne les ait trop sévèrement jugés. Si, nous autres lecteurs, nous ne sommes pas tous des génies, nous ne sommes pas cependant tous d'absolus imbéciles; et les œuvres de M. Gide ne sont pas vraiment si abstruses pour que de toute nécessité elles aient besoin d'éclaircissements. Du reste l'avant-propos de Paludes le déclare : « Si nous savions ce que nous voulions dire nous ne savons pas si nous ne disions que cela — On dit toujours plus que CELA... Attendons de partout la révélation des choses ; — du public, la révélation de nos œuvres. » Alors pourquoi se plaindre ensuite « des protestations infinies » soulevées par son livre, et pourquoi s'irriter de « n'avoir pas été compris ». Vous dites vous-même que ce qui vous intéresse dans Paludes « c'est que vous y avez mis sans le savoir ». Pourquoi donc ne voulez-vous pas admettre que mes commentaires, fussent-ils stupides, ne vous révéleront pas « cette part d'inconscient » que vous « avez mis dans votre livre, et ce que vous voudriez appeler la part de Dieu » ? Je suis votre public, écoutez-moi, même si je déraisonne ; car si je déraisonne, il se peut que votre livre en soit la cause et vous aurez ainsi appris par moi que dans votre œuvre était la déraison : je vous aurai rendu service. Si vous avez le sentiment de la justice, vous m'en serez reconnaissant. Que M. Gide me pardonne donc d'oser discuter la qualité de son rire. Il est trop continu et trop toujours le même, il rappelle le rire hystérique qui finit par inquiéter, tant il se prolonge, et il résulte d'un genre de comique qui ne varie pas assez : le comique dans les mots. Ce comique n'exige que de l'esprit et quelque souplesse de style consistant en des rapprochements, des oppositions, des transpositions ou des cadences ; il suffit d'avoir étudié sa langue et de savoir s'en servir. Mais il y a deux autres comiques qui sont d'un ordre plus élevé : c'est le comique dans les caractères et le comique dans les situations, que, seule, l'observation de la vie nous permettra de percevoir. Paludes ne nous présente le deuxième que rarement, par exemple la soirée chez Angèle; quant au premier, il en est complètement absent. Ce Je qui parle tout le long du livre, en lui-même n'est pas risible ; Angèle et ses amis, non plus. C'est que Je est un individu malade, tandis qu'Angèle et ses amis sont des êtres insignifiants. La personnalité de l'un est plutôt tératologique, au lieu que celle des autres demeure à peu près amorphe. Ceux-ci pèchent par défaut, et celui-là par excès. D'où, un manque d'harmonie dans l'ensemble, et un déséquilibre général qui s'aggrave de ce que tous ces personnages sont plus ou moins artificiels. M. Gide les a songés, il ne les a pas vus : son Je est impossible. Il a voulu nous conter « l'histoire de la maladie qu'une idée cause dans tel esprit ». Et il est tombé dans une erreur analogue à celle que j'ai critiquée à propos du Voyage d'Urien. Pour lui, en effet, l'idée est, comme l'émotion, en ce sens qu'elle est en dehors de nous et qu'elle fait partie du royaume de Dieu. « Elle est dévoratrice et se nourrit de nous; nous ne sommes ici que pour lui permettre de vivre... et elle vit à nos dépens... nous sommes voués à l’idée. » Ainsi le paysage est voué à l'émotion. « Nous ne nous sauverons pas de cela ; on ne s'échappe pas de Dieu : Dieu nous possède infiniment. Dévouons-nous donc a l'Idée. » Il serait oiseux de discuter une telle métaphysique, étant donné qu'elle se borne à affirmer sommairement. Mais, de même que pour Urien, nous voyons dans Paludes à quoi elle aboutit : simplement à des efforts vers la vie. Toutefois ne l'en blâmons pas. Car cette préoccupation de vivre est ce qui fait de M. Gide une des personnalités les plus intéressantes de la génération qui vient. C'est elle, si elle persévère, qui le dégagera de toute cette littérature dont il s'embarrasse. J'entends ici par littérature ce goût pour les formes oratoires et emphatiques, ce penchant vers l'artificiel et le factice, cette inclination pour des paradoxes philosophiques et des raisonnements hasardés, en un mot cette imagination qui se souvient trop de la science puisée dans les livres et qui gâte fâcheusement ses plus sincères élans. Il faut que M. Gide oublie ce qu'il a appris. Lorsqu'il se sera baigné dans la nature, à la source de la jeunesse éternelle, il deviendra superbe et vigoureux. La noblesse de son style aura gagné en ampleur. Il aura rejeté les attitudes forcées, les sursauts trop brusques, les tournures conventionnelles ou même irrégulières qui parfois le détériorent. Mais la passion l'animera selon des lignes belles et pures. Alors M. Gide n'aura plus devant la vie l'émotion grêle et la lassitude triste d'Urien et de ses marins ; il ne sera plus convalescent ainsi qu'il fut au moment de Paludes. Il comprendra que la vie est claire, simple et logique. Il saura la chérir pour elle-même et non plus pour de pénibles théories idéologiques. Et nous-même, qui déjà l'aimons beaucoup, si tous ces vœux se réalisent, nous n'aurons plus à l'ennuyer de nos critiques, et nous l’aimerons encore plus que maintenant.
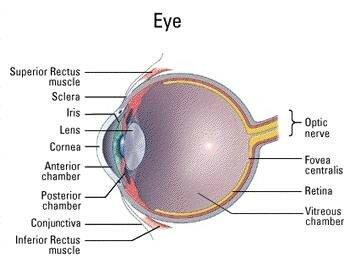
L'oeil
humain est un système optique d'une grande complexité ; son
fonctionnement, même si l'on se cantonne à une description élémentaire,
suppose une parfaite adéquation entre plusieurs composants complexes :
L'iris,
équivalent du diaphragme de nos appareils photos, régule la quantité de
lumière reçue. Le cristallin, équivalent de l'objectif, est une
lentille biconvexe qui a la propriété de se déformer pour ajuster la
mise au point (réglage de la focale). La rétine, soit la pellicule,
contient quelques 125 millions de cellules photosensibles (comparez
cette valeur à la résolution de votre appareil photo numérique). Elle
reçoit - indirectement - une image parfaitement nette, grâce au bon
fonctionnement des deux autres organes décrits, assure un
pré-traitement et envoie l'information visuelle au nerf optique à fin
de traitement définitif par le cerveau.
Un tel système ne peut
fonctionner qu'à l'état achevé. Le dysfonctionnement d'un seul des
composants entraîne une vision imparfaite, soit une image non
reconnaissable, voire pas de vision du tout.
Dans ce contexte,
il apparaît très difficile d'expliquer l'apparition de l'oeil dans un
cadre évolutionniste. Puisque le système n'est fonctionnel qu'à l'état
achevé, que l'évolution ne peut procéder que par micro-mutations,
comment imaginer une chaîne complète, conférant un avantage évolutif
strictement croissant, allant de l'absence de perception visuelle à
l'oeil moderne ?
Pour les tenants des approches alternatives,
cette chaîne n'existe tout simplement pas, elle n'est pas possible : la
probabilité de coévolution des composants de l'oeil, dans le strict
respect de l'avantage évolutif, est trop faible pour pouvoir être
acceptée.
Pour Darwin, qui s'est penché sur le cas de l'oeil
dans la partie "Difficultés de la Théorie" de son texte fondateur,
cette chaîne doit exister, même si les archives fossiles n'en
permettent pas la reconstitution. Ce cas interroge néanmoins fortement
Darwin. C'est au cours de son traitement qu'il a écrit cette fameuse
phrase ayant fait le bonheur des créationnistes : "Si l'on arrivait à
démontrer qu'il existe un organe complexe qui n'ait pas pu se former
par une série de nombreuses modifications graduelles et légères, ma
théorie ne pourrait certes plus se défendre.".
Dawkins est un
des chantres de l'évolution. Pour lui, cette fameuse chaîne existe.
Mieux encore, on peut en reconstituer les principales étapes.
Dawkins
commence par rejeter le raisonnement selon lequel un oeil incomplet est
un organe inutile. A son sens, "5 % d'oeil valent mieux que pas d'oeil
du tout". Imaginons le premier organisme doté de composants
photosensibles. Ces composants sont très imparfaits, ils lui permettent
à peine de distinguer des variations de luminosité. Pourtant, ils sont
suffisants pour que - une fois, deux fois.... - il puisse échapper à
ses prédateurs. A partir de là, le mécanisme de la Sélection Naturelle
pourra jouer son rôle.
Si 5 % d'un oeil confère un avantage
évolutif, il doit être possible de trouver, encore à l'heure actuelle,
des organismes dotés d'yeux "incomplets". C'est bien ce que montre
Dawkins, de nombreux animaux (invertébrés essentiellement) sont dotés
d'yeux n'ayant que quelques uns des composants de l'oeil moderne.
Certains unicellulaires disposent d'un simple "point sensible"; des
mollusques disposent d'une couche de cellules photosensibles disposées
dans une cuvette, ce qui leur permet d'avoir une idée de la direction
de la lumière. Les nautiles sont célèbres pour leur oeil "vide" :
disposant de l'essentiel des composants d'un oeil moderne, il n'a pas
de cristallin et se présente donc sous la forme d'une poche ouverte
dans laquelle l'eau circule.
D'après Dawkins, il existe donc
une chaîne complète de micro-évolutions qui conduit de l'absence d'oeil
à l'organe que l'on connaît. Pour lui cette dynamique peut
s'interpréter comme relevant d'une fonction continue : on peut
parfaitement imaginer une série de mutations - toujours plus
petites - qui permette de passer d'un état à un autre.
L'analyse
de Dawkins est très convaincante. Qu'il s'agisse de l'oeil, de l'aile
ou de l'écholocation, sa présentation d'une chaîne continue de
micro-mutations toujours favorables apparaît pleinement crédible. On
relèvera toutefois deux grands types de critiques :
- Il
est difficile d'accepter que l'on puisse considérer des "mutations
toujours plus petites" tout en admettant qu'elles soient
systématiquement porteuses d'un avantage adaptatif suffisant pour que
puisse jouer pleinement la Sélection Naturelle. Si 5 % d'un oeil
permet par exemple de se faire une idée de la direction de l'objet vu,
alors que 2 % ne permettait que de distinguer une variation d'intensité
lumineuse, on peut croire que l'individu porteur de cette mutation
dispose d'un avantage suffisant pour le transmettre en beaucoup plus
forte quantité que les autres individus. Mais si le sixième pour-cent
n'apporte qu'une très légère amélioration du sens de la direction,
est-il crédible d'admettre que cet avantage sera suffisant pour se
transmettre ? Et, si l'on suit le raisonnement de Dawkins, qu'en
sera-t-il du passage de 6 % à 6.01 % ?
- Il existe des cas où
l'existence même de la chaîne est impossible. On citera à la suite de
Denton le cas des capsides virales qui sont soit cylindriques, soit en
forme d'icosaèdres. Ces formes sont parfaitement expliquées à partir
d'une simple application des lois de la physique. En revanche, il
n'existe pas de structures intermédiaires permettant de passer de l'un
à l'autre, toute structure intermédiaire étant instable. On peut
également, à titre d'illustration , citer le cas du poumon aviaire.
Chez les vertébrés, l'air entre et sort des poumons par les mêmes
voies, circulant une fois dans un sens, une fois dans un autre. Dans le
cas des oiseaux, il existe un mécanisme complexe assurant un sens de
circulation unique. Là encore, ce système nécessite le parfait
fonctionnement simultané de plusieurs composants. Sans entrer dans les
détails, et considérant l'importance d'un quelconque dysfonctionnement
du système respiratoire, comment décrire la chaîne parcourue du poumon
classique au poumon aviaire ?
Ces critiques sont fondées. Elles
montrent que la Théorie de l'Évolution, à son stade actuel, reste
incomplète. Elle n'en demeure pas moins, et de loin, la plus féconde et
probablement la plus proche de la réalité, de toutes les théories
scientifiques proposées pour expliquer l'histoire et la
complexité de la vie.

Albert Camus est né à Mondovi (Algérie) le 7 novembre 1913 ; il est mort près de Villeblevin (Yonne) le 4 janvier 1960 d'un accident d'automobile. Son père, ouvrier agricole, fut tué en 1914 à la guerre. Sa mère, d'origine espagnole, vient alors habiter un quartier populaire d'Alger. En 1918, il entre à l'école communale. Il obtient une bourse et fréquente le lycée d'Alger jusqu'en 1930, année où il subit les premières atteintes de la tuberculose. Il fait des études de philosophie sous la direction de Jean Grenier qui restera son ami. Il se marie en 1933, divorce en 1935, date à laquelle il adhère au parti communiste, dont les prises de position envers les Arabes provoquent sa démission en 1936.
Il fonde le "Théâtre du Travail", participe à la rédaction collective d'une pièce, Révolte dans les Asturies et commence à écrire L'Envers et l'endroit. Il se livre à des métiers divers afin de poursuivre ses études. Il présente un diplôme d'études supérieures sur "Les rapports de l'hellénisme et du christianisme à travers les œuvres de Plotin et de saint Augustin". Il lit Epictète, Pascal, Kierkegaard, Malraux, Montherlant. Il parcourt l'Algérie avec la troupe théâtrale de Radio-Alger, adapte Le Temps du mépris de Malraux, Le Retour de l'enfant prodigue de Gide, le Prométhée d'Eschyle et joue lui-même diverses pièces dont une adaptation des Frères Karamazov de Dostoïevski. Il visite l'Espagne, l'Italie, la Tchécoslovaquie, lit Albert Sorel, Nietzsche et Spengler. En 1938, journaliste à L'Alger Républicain, il commence à écrire Caligula, publie Noces et pense déjà à l'Etranger et au Mythe de Sisyphe. En 1939, il enquête sur la Kabylie et s'attire l'animosité du Gouvernement Général. Il se remarie en 1940, vient à Paris, fait du journalisme, retourne en Algérie et revient en France en 1942. Il lit Tolstoï, Marc Aurèle, Vigny, rédige La Peste au moment où paraît L'Etranger. Il entre dans le mouvement de résistance "Combat" qui le délègue à Paris en 1943. A la Libération, il devient rédacteur en chef du journal Combat. En 1944, il fait représenter Le Malentendu – puis Caligula en 1945, L'Etat de siège en 1948 et Les Justes en 1950. En 1946, il parcourt les Etats-Unis et en 1947 il publie La Peste. Il lit Simone Weil et s'élève dans Combat contre la répression de la révolte malgache, signe en 1949 un appel en faveur des communistes grecs condamné à mort. Il voyage en Amérique du Sud. Il fait paraître l'Homme révolté (1951), qui sera suivi d'un débat avec Jean-Paul Sartre, cause de leur rupture. En 1952, il démissionne de l'UNESCO qui a admis l'Espagne franquiste en son sein. En juin 1953, il se prononce en faveur des ouvriers tués au cours des émeutes de Berlin-Est. En 1955, il voyage en Grèce et est amené à s'entremettre dans le drame de l'Algérie. Il lance à Alger, devant les membres des différentes communautés musulmanes, un appel à la trêve. Il publie La Chute en 1956, travaille à la mise en scène de Requiem pour une nonne tiré d'un roman de Faulkner, s'élève contre la répression des insurgés hongrois par les Soviétiques. En 1957, il publie un recueil de nouvelles, L'Exil et le royaume, puis Réflexions sur la peine de mort. Il reçoit la même année le Prix Nobel de Littérature. Il meurt en 1960 dans un accident de voiture.
"Admirable conjonction d'une personne, d'une action et d'une œuvre." Ainsi Jean-Paul Sartre définit-il les raisons de l'influence qu'exerça Albert Camus sur un public fervent. Sa seule biographie permet déjà de remarquer qu'il prit toujours la position qui s'imposait quand l'histoire soulevait une question morale d'importance. L'œuvre semble capable, elle aussi, d'inspirer des choix nouveaux comme l'indiquent des sondages renouvelés auprès de la jeunesse, qui continue à la placer très haut. Ce qui fait sa force, c'est sa flexibilité. Ce n'est pas une philosophie en forme que l'on trouve dans ces livres. C'est une pensée qui s'articule autour de mots clefs – absurde, révolte – et trouve sa meilleure expression dans le roman, le théâtre et l'essai.
De l'aveu même de Camus, cette œuvre comprend deux cycles. A celui de l'absurde appartiennent Caligula, L'Etranger, Le Mythe de Sisyphe et Le Malentendu, ce qui couvre les livres parus entre 1942 et 1944. Au cycle de la révolte correspondent La Peste, L'Etat de Siège, Les Justes et L'Homme révolté, donc les livres publiés entre 1947 et 1950. Classement qui laisse de côté les œuvres de jeunesse et celles de la maturité, notamment La Chute, qui annonçait un nouveau départ.
Dans le deuxième Cahier Albert Camus, Paul Viallaneix souligne que deux élément ont joué très tôt un rôle de "valeurs sensibles" : la pauvreté et le soleil. Mais déjà dans Noces apparaît la présence secrète de la mort qui menace le bonheur physique. "Tout ce qui exalte la vie accroît en même temps son absurdité." L'absurde se présente sous deux aspects : discordance de l'homme et du monde extérieur – désaccord de l'homme avec lui-même. L'Etranger concrétise l'absurdité considérée sous ces deux angles. C'est dans une sorte de rêve éveillé provoqué par le soleil que Meursault tue un Arabe. Dans la seconde partie, le procès se heurte à une société absurde. Dans la préface que Camus a écrite pour l'édition américaine de son roman, il déclare : "Bien que (Meursault) soit privé de toute sensibilité, une passion profonde, parce que tacite, l'anime, la passion de l'absolu et de la vérité". Passion que contredit le cours ordinaire de la vie. Le Mythe de Sisyphe, qui n'est pas un texte théorique dont L'Etranger serait l'application, approfondit la notion d'absurde. La vie vaut-elle la peine d'être vécue dans un monde sourd à l'absolu et à la vérité ? Le suicide n'est-il pas la solution à cette question ? Repoussant toute transcendance religieuse ou philosophique, Camus demande qu'on vive cependant, mais les yeux fixés sur cette absurdité. C'est là le fondement d'une lucidité qui se traduit par la révolte, la liberté et la passion. L'absurde trouve des prolongements au théâtre. Caligula a appris que les hommes meurent et ne sont pas heureux. Il demande l'impossible, la lune. Le Malentendu soulève la question du langage. C'est faute de trouver les mots justes que meurt le voyageur.
La Résistance va apprendre à Camus que l'absurde peut mener à des excès meurtriers. Il faut donc lui trouver un butoir. Si ce monde n'a pas de sens, l'homme du moins en est-il un. "Il est le seul être à exiger d'en avoir un" ( Lettres à un ami allemand, 1944). Au nihilisme s'oppose la révolte. "Je crie que je ne crois à rien et que tout est absurde, mais je ne puis douter de mon cri et il me faut au moins croire à ma protestation". En se révoltant, l'homme engage par là même la communauté humaine. "Je me révolte donc nous sommes". La Peste, allégorie du nazisme, définit à travers les prises de position d'un certain nombre de personnages exemplaires des impératifs face au mal : ne pas s'en rendre responsable, secourir, comprendre. L'Etat de siège reprend le même thème à la scène. Les Justes mettent en valeur la responsabilité individuelle. Un homme peut-il en tuer un autre en vue du bien futur de l'humanité ? Débat qui est au centre de L'Homme révolté, ouvrage qui marque de la part de Camus un certain éloignement par rapport à l'existentialisme.
Il s'élève contre la divinisation de l'Histoire. La révolte qui vise à rétablir la justice, si elle dégénère en révolution, la voici qui instaure le terrorisme d'État. Ici, Camus devance les prises de position des "nouveaux philosophes" face aux pouvoirs politiques et aux goulags. A l'époque, L'Homme révolté souleva une violente protestation de la part des progressistes. Camus, touché dans sa sensibilité, s'interroge : est-il la "belle âme" que certains veulent voir en lui ? Une tragédie le déchire à la même époque, la guerre d'Algérie. Il se déclare opposé à une attitude conservatrice ou d'oppression mais aussi à une pure démission. Il finira par se taire, persuadé que toute parole dans une pareille situation prêtera au malentendu.
Avec La Chute, il atteint deux objectifs. Ce roman vise les intellectuels de gauche des années 50 dont il dénonce la mauvaise foi, qui instruisent le procès de leur époque pour mieux s'encenser eux-mêmes et montrer ainsi leur belle âme. Cette arme, Camus la retourne ensuite contre lui-même. Toutes les vertus qui firent de l'avocat Jean-Baptiste Clamens un avocat parisien fêté ne sont-elles pas subterfuges hypocrites ? Devenu à Amsterdam "un juge pénitent", il dénonce le mal universel mais il ne s'exempte pas de le partager. Tout le monde est coupable et cette culpabilité intérieure, nul ne doit l'oublier au moment où il combat le mal.
Que Camus ait situé son roman dans les brumes du Nord amplifie encore le climat oppressant du roman. L'Afrique du Nord a toujours été le lieu du monde où, pour Camus, s'opèrent entre l'homme et le cosmos des échanges bénéfiques. Et voici que cet endroit privilégié se voit à son tour contaminé, comme le montre L'Exil et le royaume. Camus, l'homme méditerranéen, l'homme des limites, de la mesure, de l'équilibre, recherche ici, une fois encore, la réintégration de l'homme dans son royaume, qui se situe sur cette terre même.
Après les cycles de l'absurde et de la révolte, Camus envisageait de donner le cycle de la mesure. Il se trouvait à cet égard affronté depuis longtemps à une contradiction : l'Histoire est une dimension où l'homme est amené à vivre nécessairement. Pourtant, il ne doit pas s'y perdre. L'œuvre d'art permet de résoudre ce dilemme. "L'art nous ramène ainsi aux origines de la révolte dans la mesure où il tente de donner sa forme à une valeur qui fuit dans le devenir perpétuel, mais que l'artiste pressent et veut ravir à l'Histoire." On est loin ici d'une esthétique qui correspondait à la période de l'absurde, où l'œuvre d'art n'avait qu'une fonction : fixer la conscience sur un monde mécanique dénué de sens. De L'Homme révolté, de l'article L'Artiste et son temps et du Discours de Suède (1957), se dégage une esthétique humaniste. L'écrivain diagnostique et exorcise les passions meurtrières non plus sur le plan individuel mais sur le plan collectif. L'art corrige le réel sans l'éliminer, il est communicable à tous, donc incitation au dialogue et donc à la liberté. Au-delà du cycle de la mesure, Camus pensait déjà au cycle de l'amour. Etait-ce le roman dont il avait déjà choisi le titre, Le Premier Homme, qui devait l'inaugurer ?
GUY LE CLEC'H

Dieu,
Dieu, d'abord ce n'est pas à toi Dieu,
ce n'est pas à Dieu que je parle,
Dieu, je parle à ton inexistence,
je lance droit mes yeux comme des pierres
non pas sur toi, je lance droit mes deux yeux vers tout endroit,
droit vers tout endroit où tu n'es pas
comme des pierres lancées mais dans le vide
comme des balles perdues
je lance ma voix comme une pierre vers tout endroit,
tout droit vers tout endroit où tu n'es pas,
je lance ma voix dans tout l'espace, mais, Dieu,
en nul endroit, tu n'as d'oreille
Dieu, bon Dieu, sacré bon Dieu,
sans barbe,
sans cheveux,
sans un poil.
Tu n'es pas bon, pas sacré, pas sacré bon,
sacré bon Dieu, je ne blasphème pas,
vieux sans âge, sourd sans oreille,
je te prie encore bien moins.
Tu n'en as pas un œil de Dieu, Dieu,
pas un bras de Dieu, Dieu,
pas un pied de Dieu, pas un ventre de Dieu,
pas une peau de Dieu, Dieu,
Dieu sans homme
Dieu sans diable
Dieu sans dieu.
Dieu, sacré nom de Dieu en quatre lettres
D comme Désir
I comme Imbécile
E comme Éclairage
U comme Universel.
nom de nom,
non de nom,
sacré non de nom de non-Dieu
mais tu m'as fait assez rigoler, punaise !
voici la rage qui monte rouge entre les dents
voici mon regard, lancé dans le vide, qui cogne
contre un œil, voici ma voix qui cogne,
contre une oreille, voci mes balles perdues dzing!
et dzing qui giclent contre une trogne réelle,
contre une vraie gueule grasse et violette
ou bien contre une vraie gueule de citron pourri
ou un sourire en paire de tenailles. Quelqu'un.
Il s'amène, il te parle. Dieu,
il te prie. Dieu, il parle de Dieu,
il te met des binocles sur ton inexistence,
il affuble d'oreilles postiches ton inexistence,
et il se met des grands poils blancs,
des poils partout tout autour de ton néant.
Dieu, sacré nom de Dieu en quatre lettres,
il n'y a plus moyen de s'entendre
il gueule, le putois, il gueule : Dieu, Dieu,
il s'amène, le curé, criant ton sacré nom en quatre lettres,
il s'amène avec sa sacrée trogne
et son Désir Imbécile d'Éclairage Universel.
Pauvre sacré bon Dieu de rien !
ce n'est pas ta faute, si tu as ce sale visage poilu
blanc et rosé de doux gâtisme,
c'est ce salaud qui a peint cette ordure,
c'est ce curé qui t'a collé au ciel,
avec son Désir Imbécile d'Éclairage Universel,
c'est lui qui t'a peinturluré cette face sénile
à son image, le sinistre vieillard
gâtant et dégâtant les fronts durs des hommes
per omnia saecula saeculorum.
Et moi, prêtre, je te crache au nom de Dieu à la figure,
— c'est par hygiène,
et c'est un geste rituel —
et je m'adresse à cet homme mort
ce tout petit homme mort
— tu ne le vois pas ? idiot, tu le tiens dans ta main,
tu l'as cloué sur deux morceaux de bois —
Homme mort mon vieux frère
Homme mille et mille fois mort ;
en tous pays mille et mille fois assassiné
par cette race pullulante des rats qui parlent à Dieu,
Tu avais des yeux, mon vieux frère, et qui voyaient !
tu avais une voix qui réveillait les morts-vivants millénaires,
qui réveillait une vie violente au cœur des esclaves,
tu avais au complet tout le pauvre petit bagage d'un
homme,
tu as tout donné
tes yeux, ta bouche et tout le reste,
à tes frères pour qu'ils se fassent un Dieu
avec tes pauvres débris d'homme.
Tu donnas tout.
L'homme que tu avais été n'était plus.
Et tout à coup, tu fus face à face
avec le Néant de Dieu.
Ce soir-là, sur le mont des Oliviers,
toi, l'homme qui te reniais homme,
toi, seul, déjà sacrifié jusqu'à la moelle de l'âme,
tu vis le propre néant de ta face
devant toi
tu vis Dieu face à face de néant,
Oh ! oui alors en cet instant quel éclair
quelle colonne fulminante sur la terre
entre ton néant d'homme et le néant de Dieu
tu avais tué ton passé d'homme
tu avais tué ton espoir d'avenir divin
Alors oh! oui alors seulement ce fut l'unique présence
de l'Homme, de Dieu,
de l'Homme identique à Dieu dans son néant,
identique pourtant en un instant, le seul,
Christ, néant d'homme, sur la montagne aux Olivier-
Christ, néant de Dieu, sur la montagne aux Olivier-
tu te vis, tu vis Dieu, Dieu te vit
dans le miroir fulgurant et sans forme...
alors, toi, crapule, — tu peux hurler,
mes ongles à travers le col de ta soutane
agrippent déjà ton cœur pourri,
et des cohortes millénaires d'esclaves,
tes victimes, mes frères, mes dieux,
sont la force de mes bras, donc
donc tu sais que tu vas claquer comme une puce
entre mes ongles — "y a pas de bon dieu
y a pas de bon dieu", crapule,
"y a pas de bon dieu" dit la rumeur humaine de mes bras,
alors toi tu as pris mon vieux frère
— comment pouvait-il ne pas se laisser tuer,
après l'éclatement de cette vie sur la Montagne —
tu as bavé sur son visage d'homme,
tu l'as insulté du nom de roi,
tu l'as cloué sur cette vergue et sur ce mât,
tu lui mis dans la bouche tes paroles menteuses
et tu lui soufflas ton vent de peste dans les reins.
Et, curé, tu as pris la barre de ce Bateau,
traîné par sa voile pantelante de chair humaine,
le long des siècles,
et ce Bateau —je dis bien : ce Ba-teau,
ce formidable Bateau
monté pour des siècles par toi, curé,
ce Bateau nommé Chrétienté
traîné par des cohortes pantelantes d'esclaves
le long des siècles chrétiens,
ce Bateau tu le prêtas, [moyennant des rétributions fort honorables, n'est-ce pas, Pape?]
à des rois: ils t'amenaient leurs galériens,
puis aux mouches qui s'abattirent sur les charognes royales,
car cette bourgeoisie t'amène aussi ses galériens
[ — mais, attention, mon petit curé ! ceux-ci, je crois, ne s'en laisseront sans doute plus conter pendant bien longtemps —]
Et le long des siècles chrétiens
ta parole de mensonge, par quatre bouches évangélistes,
enflées du Désir Imbécile d'Eclairage Universel,
trahit la chair immobile de mon vieux frère,
cloué au mât et à la vergue,
irresponsable de ton Bateau, chacal,
lui qui fit le Néant de Dieu avec le Néant d'Homme
oui... mais lui aussi qui coule en cohortes de chairs humaines
dans les veines de mes doigts qui se resserrent
et tiens, voici ton sale cœur qui claque,
tu es crevé, rat.
Ce n'est pas fini à si bon compte ;
un de crevé, mille renaissent :
n'approchez pas, vermine ecclésiastique.
La voile de chair pantelante vogue toujours,
le Cadavre de mon vieux frère, aveugle, sourd,
traîne toujours le Bateau,
le Bateau Chrétienté dans les siècles.
Il n'avait pas voulu cela... Mais
mais après tout, ce Cadavre est Cadavre,
j'ai beau t'aimer du fin fond du désespoir,
homme mon vieux frère, tu n'es plus qu'une charogne.
Ton corps torturé, que tu nous jetas en pâture,
il pue comme puera mon cadavre d'homme,
il est mangé par des millions de vers
catholiques romains, par des vers
orthodoxes, par des vers
protestants, par des vers
plus grouillants et plus conformes les uns que les autres
à la vraie pureté authentique de la grande pestilence chrétienne,
et partout, à l'Est sous les noms divers
de Krishna, de Bouddha, de Fô,
tous retombés à la même charogne,
partout mon vieux frère sous trente-six noms
tu es mangé par des millions de vers
plus grouillants et plus conformes les uns que les autres
à la vraie pureté authentique de la grande pestilence
brahmanique, de la grande pestilence
bouddhique, de la grande pestilence
lamaïste, de la grande pestilence
taoïste, de la grande pestilence universelle
de la puante odeur de sainteté.
Charogne crucifiée, fleurit les cimetières ;
car ta vie, mon vieux frère, a quitté ce Bateau,
ta vie, déjà distribuée entre nous tous,
un peu avant la fameuse histoire de la croix,
là-haut, sur la montagne aux Oliviers,
où tu sacrifiais l'Homme et Dieu dans le même Néant.
Ta vie n'est plus dans ce cadavre en croix;
elle a vomi ce Bateau et toute la race de cancrelats,
qui parlent de Dieu, sous la quadruple protection
des saintes gueules évangélistes.
Ta vie s'est multipliée dans des foules sans nombre,
dans des cohortes d'hommes saignants,
torturés toujours par les mêmes bourreaux,
sous la sainte protection toujours des mêmes prêtrailles
per omnia saecula saeculorum
dans les siècles de Royauté de droit divin,
dans les siècles de Bourgeoisie de droit divin,
per omnia saecula saeculorum.
Si le Néant de Dieu fut Quelque Chose
en cet instant où en l'Homme il se nia,
Dieu tu es le bois d'ébène, la chair noire,
que la charité chrétienne des poux missionnaires
aide à mourir chrétiennement
— plusieurs dizaines par km de voie ferrée —
pour la plus grande gloire de la civilisation chrétienne,
pour tirer le bateau Chrétienté,
Dieu serpentin aux millions de têtes noires
qui te roules de souffrance au travers de l'Afrique,
en toi se mûrit, se pèse et d'avance se savoure
la vengeance de mon vieux frère, et toi,
Dieu serpentin aux milliards de têtes jaunes
qui éclatent sous les balles de coton,
sous les bombes des avions bénis au départ
par une main chrétienne,
Dieu vivant, sur tes têtes innombrables
et renaissantes s'use la guillotine,
le sang du vieux frère coule aussi dans tes veines,
et mûrit et savoure déjà sa vengeance
à travers aussi le Dieu noir et blanc
qui piétine tout le long de l'Amérique,
à travers le Dieu aux millions de têtes pâles,
aux mains noires, mais,
mais bientôt rouges, mais
mais pardon mon vieux frère,
pardon de t'avoir sali du nom de Dieu.
C'est tout ton sang qui gonfle ces peaux d'hommes,
y a pas de bon dieu, y a pas de bon dieu,
ton sang océan rouge où tu noieras enfin,
y a pas de bon dieu, ce milliard de curés,
de sous-curés, d'archis-curés, de saligauds,
y a pas de bon dieu, à toi,
à toi la Parole
à toi, humain Néant de Dieu :
quand les cinq doigts de ta main rouge
auront essuyé la face du monde,
alors, campe devant toi le passé humain,
vise au cœur, pan !
et seul, ayant purifié la face du monde
par le feu de la vengeance des vieux frères,
de toute vermine, de toute cette vermine
qui te redoute déjà et te soupçonne
sous le nom de l'Antéchrist,
seul, être aux têtes pâles, jaunes, noires,
seul, oui, véritable Antéchrist,
— Antéchrist pour faire trembler cette vermine chrétienne,
cette vermine bouddhiste, cette vermine
brahmaniste, lamaïste, taoïste, —
seul dans cet instant délivré
des mensonges de passé ou d'avenir,
tu recommenceras le grand miracle
— mais cette fois, par le feu de la vengeance
du vieux frère, ne laisse pas renaître la vermine —
seul face à face avec le Néant de Dieu
tu connaîtras dans ce miroir fraternel
et fulgurant
LA REALITE.
René Daumal
(El Anderson.)

* * * * *
Antaŭ multaj jaroj
vivis unu reĝo, kiu tiel amis belajn novajn vestojn, ke li elspezadis sian
tutan monon, por nur esti ĉiam bele ornamita. Li ne zorgadis pri siaj soldatoj,
nek pri teatro kaj ĉaso, esceptinte nur se ili donadis al li okazon montri
siajn novajn vestojn. Por ĉiu horo de la tago li havis apartan surtuton, kaj kiel pri ĉiu alia
reĝo oni ordinare diras: "Li estas en la konsilanejo", oni tie ĉi
ĉiam diradis: "La reĝo estas en la vestejo."
En la granda urbo, en kiu li loĝis, estis tre gaje; ĉiun
tagon tien venadis multaj fremduloj. Unu tagon venis ankaŭ du trompantoj, kiuj
diris, ke ili estas teksistoj kaj teksas la plej belan ŝtofon, kiun oni nur
povas al si prezenti; ke ne sole la koloroj kaj desegnoj de tiu ĉi ŝtofo estas
eksterordinare belaj, sed la vestoj, kiujn oni preparas el tiu ĉi ŝtofo, havas
la mirindan econ, ke al ĉiu, kiu ne taŭgas por sia ofico aŭ estas tro malsaĝa, ĝi restas nevideblaj.
"Tio ĉi estas ja bonegaj vestoj!" pensis la reĝo;
"havante tian surtuton, mi ja povus sciiĝi, kiu en mia regno ne taŭgas por
la ofico, kiun li havas; mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! Jes, la
ŝtofo devas tuj esti teksita por mi!" Kaj li donis al la ambaŭ trompantoj
grandan sumon da mono antaŭe, por ke ili komencu sian laboron.
Ili starigis du teksilojn, faris mienojn kvazaŭ ili laboras,
sed havis nenion sur la teksiloj. Tamen en la postuloj ili estis tre fervoraj
kaj postuladis la plej delikatan silkon kej la plej bonan oron. Tion ĉi ili
metadis en siajn proprajn poŝojn kaj laboradis super la malplenaj teksiloj, kaj
eĉ ĝis profunda nokto.
"Mi volus scii, kiom de la ŝtofo ili jam pretigis!"
ekpensis la reĝo, sed kaptis lin kelka timo ĉe la penso, ke tiu, kiu estas
malsaĝa aŭ ne bone taŭgas por sia ofico, ne povas vidi la ŝtofon. Li estis
kvankam konvinkita, ke li pro si ne devas timi, tamen li preferis antaŭe sendi
alian personon, por vidi, kiel la afero staras. ĉiuj homoj en la tuta urbo
sciis, kian mirindan forton la ŝtofo havas, kaj ĉiu kun senpacienco jam volis
vidi, kiel malsaĝa lia najbaro estas.
"Mi sendos al la teksistoj mian maljunan honestan
ministron!" pensis la reĝo, "li la plej bone vidos, kiel la ŝtofo
elrigardas, ĉar li estas homo saĝa kaj neniu pli bone taŭgas por sia ofico, ol
li!"
Tiel la maljuna bonkora ministro iris en la salonon, en kiu
la ambaŭ trompantoj sidis antaŭ la malplenaj teksiloj kaj laboris. "Dio,
helpu al mi!" ekpensis la maljuna ministro, larĝe malfermante la okulojn,
"mi nenion povas vidi!" Sed li tion ĉi ne eldiris.
La ambaŭ trompantoj petis lin alveni pli proksime kaj
demandis, ĉu ĝi ne estas bela desegno kaj belegaj koloroj. ĉe tio ĉi ili
montris la malplenan teksilon, kaj la malfeliĉa ministro uzis ĉiujn fortojn por
malfermi bone la okulojn, sed li nenion povis vidi, ĉar nenio estis.
"Mia Dio!" li pensis, "ĉu mi estas malsaĝa?
tion ĉi mi neniam supozis kaj tion ĉi neniu devas sciiĝi! ĉu mi ne taŭgas por
mia ofico? Ne, neniel mi povas rakonti, ke mi ne vidas la teksaĵon!"
"Nu, vi ja nenion diras!" rimarkis unu el la
teksantoj.
"Ho, ĝi estas bonega, tre ĉarma!" diris la maljuna
ministro kaj rigardis tra siaj okulvitroj. "Tiu ĉi desegno kaj tiuj ĉi
koloroj! Jes, mi raportos al la reĝo, ke ĝi tre al mi plaĉas!"
"Tre agrable al ni!" diris la ambaŭ teksistoj kaj
nomis la kolorojn kaj komprenigis la neordinaran desegnon. La maljuna ministro
atente aŭskultis; por povi diri tion saman, kiam li revenos al la reĝo; kaj
tiel li ankaŭ faris.
Nun la trompantoj postulis pli da mono, pli da silko kaj oro,
kion ili ĉiam ankoraŭ bezonis por la teksaĵo. Ili ĉion metis an sian propran
poŝon, en la teksilon ne venis eĉ unu fadeno, sed ili, kiel antaŭe, daŭrigadis
labori super la malplenaj teksiloj.
La reĝo baldaŭ denove sendis alian bonkoran oficiston, por
revidi, kiel iras la teksado kaj ĉu la ŝtofo baldaŭ estos preta. Estis kun li
tiel same, kiel kun la ministro: li rigardadis kaj rigardadis, sed ĉar krom la
malplena teksilo nenio estis, tial li ankaŭ nenion povis vidi.
"Ne vere, ĝi estas bela peco da ŝtofo?" diris la
trompantoj kaj montris kaj klarigis la belan desegnon, kiu tute ne ekzistis.
"Malsaĝa mi ja ne estas! pensis la sinjoro, tial sekve
mi ne taŭgas por mia bona ofico. Tio ĉi estas stranga, sed almenaŭ oni ne devas
tion ĉi lasi rimarki!" Tial li laŭdis la ŝtofon, kiun li ne vidis, kaj
certigis ilin pri sia ĝojo pro la belaj koloroj kaj la bonega desegno. "Jes,
ĝi estas rava!" li diris al la reĝo.
ĉiuj homoj en la urbo parolis nur pri la belega ŝtofo.
Nun la reĝo mem volis ĝin vidi, dum ĝi estas ankoraŭ sur la
teksiloj. Kun tuta amaso da elektitaj homoj, inter kiuj sin trovis ankaŭ la
ambaŭ maljunaj honestaj oficistoj, kiuj estis tie antaŭe, li iris al la ruzaj
trompantoj, kiuj nun teksis per ĉiuj fortoj, sed sen fadenoj.
"Nu, ĉu tio ĉi ne estas efektive belega? diris ambaŭ
honestaj oficistoj. Via Reĝa Moŝto nur admiru, kia desegno, kiaj koloroj!"
kaj ĉe tio ĉi ili montris sur la malplenan teksilon, ĉar ili pensis, ke la
aliaj kredeble vidas la ŝtofon.
"Kio tio ĉi estas!" pensis la reĝo, "mi ja
nenion vidas! Tio ĉi estas ja terura! ĉu mi estas malsaĝa? ĉu mi ne taŭgas kiel
reĝo? tio ĉi estus la plej terura, kio povus al mi okazi. Ho, ĝi estas tre
bela", diris tiam la reĝo laŭte, "ĝi havas mian plej altan
aprobon!" Kaj li balancis kontente la kapon kaj observadis la malplenan
teksilon; li ne volis konfesi, ke li nenion vidas. La tuta sekvantaro, kiun li
havis kun si, rigardadis kaj rigardadis, sed nenion pli rimarkis, ol ĉiuj
aliaj; tamen ili ĉiam ripetadis post la reĝo: "Ho, ĝi ja estas tre
bela!" Kaj ili konsilis al li porti tiujn ĉi belegajn vestojn el tiu ĉi
belega materialo la unuan fojon ĉe la solena irado, kiu estis atendata. "Rava,
belega, mirinda!" ripetadis ĉiuj unu post la alia kaj ĉiuj estis tre
ĝojaj. La reĝo donacis al la ambaŭ trompantoj kavaliran krucon kaj la titolon
de sekretaj teksistoj de la kortego.
La tutan nokton antaŭ la tago de la parado la trompantoj
pasigis maldorme kaj ekbruligis pli ol dekses kandelojn. ĉiuj povis vidi, kiel
okupitaj ili estis je la pretigado de la novaj vestoj de la reĝo. Ili faris
mienon, kvazaŭ ili prenas la ŝtofon de la teksiloj, tranĉadis per grandaj
tondiloj en la aero, kudradis per kudriloj sen fadenoj kaj fine diris:
"Nun la vestoj estas pretaj!"
La reĝo mem venis al ili kun siaj plej eminentaj korteganoj,
kaj ambaŭ trompantoj levis unu manon supren, kvazaŭ ili ion tenus, kaj diris:
"Vidu, jen estas la pantalono! jen estas la surtuto! jen la mantelo! kaj
tiel plu. ĝi estas tiel malpeza, kiel araneaĵo! oni povus pensi, ke oni nenion
portas sur la korpo, sed tio ĉi estas ja la plej grava eco!"
"Jes!" diris ĉiuj korteganoj, sed nenion povis
vidi, ĉar nenio estis.
"Via Reĝa Moŝto nun volu plej afable demeti viajn plej
altajn vestojn, diris la trompantoj, kaj ni al Via Rega Moŝto tie ĉi antaŭ la
spegulo vestos la novajn."
La reĝo demetis siajn vestojn, kaj la trompantoj faris,
kvazaŭ ili vestas al li ĉiun pecon de la novaj vestoj, kiuj kvazaŭ estis
pretigitaj; kaj ili prenis lin per la kokso kaj faris kvazaŭ ili ion alligas -
tio ĉi devis esti la trenaĵo de la vesto - kaj la reĝo sin turnadis kaj
returnadis antaŭ la spegulo.
"Kiel belege ili elrigardas, kiel bonege ili
sidas!" ĉiuj kriis, "Kia desegno, kiaj koloroj! ĝi estas vesto de
granda indo!"
"Sur la strato oni staras kun la baldakeno, kiun oni
portos super Via Reĝa Moŝto en la parada irado!" raportis la ĉefa
ceremoniestro.
"Nu, mi estas en ordo!" diris la reĝo. "ĉu ĝi
ne bone sidas?" Kaj ankoraŭ unu fojon li turnis sin antaŭ la spegulo, ĉar
li volis montri, ke li kvazaŭ bone observas sian ornamon.
La ĉambelanoj, kiuj devis porti la trenaĵon de la vesto,
eltiris siajn manojn al la planko, kvazaŭ ili levas la trenaĵon. Ili iris kaj
tenis la manojn eltirite en la aero; ili ne devis lasi rimarki, ke ili nenion
vidas. Tiel la reĝo iris en parada marŝo sub la belega baldakeno, kaj ĉiuj
homoj sur la stratoj kaj en la fenestroj kriis: "Ho, ĉielo, kiel
senkomparaj estas la novaj vestoj de la reĝo! Kian
belegan trenaĵon li havas al la surtuto! kiel bonege ĉio sidas!" Neniu volis lasi
rimarki, ke li nenion vidas, ĉar alie li ja ne taŭgus por sia ofico aŭ estus
terure malsaĝa. Nenia el la vestoj de la reĝo ĝis nun havis tian sukceson.
"Sed li ja estas tute ne vestita!" subite ekkriis
unu malgranda infano. "Ho ĉielo, aŭdu la voĉon de la senkulpeco!"
diris la patro; kaj unu al la alia murmuretis, kion la infano diris.
"Li estas tute ne vestita; tie staras malgranda infano,
kiu diras, ke li tute ne estas vestita! Li ja tute ne estas vestita!"
kriis fine la tuta popolo. Tio ĉi pikis la reĝon, ĉar al li jam mem ŝajnis, ke
la popolo estas prava; sed li pensis: "Nun nenio helpos, oni devas nur
kuraĝe resti ĉe sia opinio!" Li prenis teniĝon ankoraŭ pli fieran, kaj la
ĉambelanoj iris kaj portis la trenaĵon, kiu tute ne ekzistis.
* * * * *

Le point de départ
Tout a commencé dans les années 1870. Bialystok est alors une ville quadrilingue: on y parle polonais, yiddish, russe et allemand. Dans cette bourgade, qui fait partie de l'empire des tsars, un jeune garçon vit de douloureuses blessures psychologiques, crucifié qu'il est entre quatre communautés, quatre religions, quatre langues, quatre alphabets, quatre haines. Là, bien plus qu'ailleurs, le simple fait de s'exprimer vous catalogue. Ou vous vous exposez au mépris, ou vous vous assurez une complicité. Tout événement se déroule sur une arrière-fond d'identités ethno-culturelles exacerbées. Si un Polonais a un problème administratif à régler, il est impensable que le fonctionnaire russe parle la langue de son interlocuteur, mais c'est la mort dans l'âme et l'esprit de vengeance au coeur que le Polonais baragouine sa requête en russe.
Rilke a dit un jour qu'un écrivain écrivait parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Le jeune Zamenhof a jeté les bases de l'espéranto pour la même raison: il ne pouvait pas faire autrement. Les identités culturelles étaient vécues, à Bialystok, comme mutuellement agressives. Or, leur manifestation première était la langue, et l'accent. Dans ce contexte, employer la langue de l'autre, ce n'est pas seulement lui reconnaître une supériorité contre laquelle l'amour propre se révolte, c'est aussi s'astreindre à une infinité d'acrobaties grammaticales, lexicales et phonétiques, c'est parcourir un terrain semé de pièges qui semblent placés là pour mieux vous faire tomber dans le ridicule et l'infériorité.
Ce climat d'hostilité et d'humiliation traumatise Zamenhof, garçon à la fois sensible et surdoué. La situation est intolérable. Il faut faire quelque chose pour que chacun, tout en gardant sa culture propre, puisse communiquer avec autrui sans ces blessures d'identité socio-culturelle qui forment la trame de la vie quotidienne à Bialystok.
Pour cela, il faut une langue qui n'appartienne à aucun peuple et dont les structures suivent le mouvement naturel de l'expression linguistique, une langue où l'on ne doive pas faire d'acrobatie, une langue accessible aux petits, aux obscurs, aux sans-grade. Avec la foi naïve de la jeunesse, l'adolescent se met au travail, associant la logique implacable de l'enfance, dont il est encore si proche, à la méthode de l'artiste, qui vise la beauté et ne cesse de polir et de repolir son oeuvre.
Quelles chances a-t-il d'aboutir? Raisonnons, si vous le voulez bien, en parieurs. Auriez-vous parié, vous, pour l'oeuvre d'un garçon de 17-18 ans, perdu dans une petite ville provinciale d'un pays provincial, qui s'était attelé à une tâche démesurée: donner l'impulsion à une langue nouvelle?
Une histoire faite d'épreuves
Reprenons cette histoire étape par étape. Voici que le père du jeune homme l'envoie étudier au loin et lui fait promettre de cesser son jeu linguistique. N'est-il pas réaliste de prévoir que le garçon va comprendre l'absurdité de son projet? En fait, il persiste. Quand il a 27 ans, il décide de publier le fruit de son travail. Il fait le tour des éditeurs. Mais ces hommes ne sont pas fous: aucun n'en veut. Il fera donc imprimer à ses frais une petite brochure, minable, car il n'a guère d'argent. Sans accès à un réseau de librairies, quelles chances a-t-il de la diffuser? Vous miseriez sur lui, un parfait inconnu, à ce moment-là?
Le projet fait tout de même quelques adeptes, essentiellement dans l'Empire russe. Une revue commence à paraître dans cette ébauche de langue. Tolstoï, enthousiasmé, se met à y écrire. Mais il tombe en disgrâce et la censure tsariste interdit cette publication, seul lien existant entre les premiers usagers. Apprenant cette nouvelle, vous parieriez, vous, qu'une langue vivante naîtra progressivement d'un projet aussi mal parti?
Mais la vie n'est pas logique. Dans les cinq parties du monde, des gens découvrent ce langage et se mettent à l'apprendre. Les linguistes se gaussent: chaque locuteur, disent-ils, va être victime de ses habitudes phonétiques, grammaticales, sémantiques. Ces gens ne se comprendront pas. Pour qui pariez-vous à ce moment-là? Pour le jeune amateur, ou pour les spécialistes unanimes?
Certes, au premier congrès, qui se tient à Boulogne-sur-Mer en 1905, les usagers de la langue se comprennent parfaitement, mais pourquoi prendrait-on au sérieux un petit groupe de farfelus? Dans l'optique des salons parisiens, qui, à l'époque, donnent le ton pour tous et sur tout, la langue n'est pas faite pour séduire. Elle est pleine de k, de j, de consonnes affublées d'accents circonflexes ridicules. Elle donne une impression d'étrangeté et de barbarie. Toute l'intelligentsia du monde, ou à peu près, la rejette. Le manque de réalisme de l'auteur apparaît d'ailleurs dans le choix saugrenu de consonnes à circonflexe qui n'existent dans aucune imprimerie, de sorte que si l'on veut publier quelque chose dans cette langue, il faut commencer par faire fondre de nouveaux caractères d'imprimerie. Allons, un peu de bon sens! Parier ne fût-ce que pour la survie de cette langue, c'est jeter son argent par les fenêtres.
La guerre de 1914 éclate. Zamenhof meurt. Faites vos jeux, Mesdames et Messieurs... Qui accepte de miser sur cette langue orpheline, symbole de relations entre égaux dans un monde agité par la loi du plus fort?
Nous arrivons aux années 20. A la Société des Nations, la délégation iranienne propose d'adopter l'espéranto dans les relations internationales. Ahurissement général! Et branle-bas de combat chez les grandes puissances. "Il faut enterrer ce projet, dangereux pour notre suprématie culturelle!" Ces États sont influents et riches, leurs délégués ne reculent pas devant la mauvaise foi la plus éhontée. Une fois encore, le projet est ridiculisé et écarté. Honnêtement, est-ce sur lui que vous auriez misé?
Voici l'avènement de Staline et d'Hitler. Pour Hitler, l'espéranto est la langue de la conspiration juive et des francs-maçons, pour Staline, celle du cosmopolitisme bourgeois. Dans les années 40, ces deux hommes exercent le pouvoir sur la quasi-totalité de l'Europe continentale. L'espéranto est interdit, ses stocks de livres sont liquidés, bon nombre de ses partisans sont enfermés dans les camps de concentration. Au Japon, en Chine, en Espagne, au Portugal, les régimes au pouvoir pratiquent à son égard une politique moins violente, mais qui va dans le même sens. Pour quelle issue raisonnablement parier à cette époque, sinon pour la mort de l'espéranto à bref délai?
La fin de la deuxième guerre mondiale voit l'entrée en scène de l'interprétation simultanée. Celle-ci résout apparemment le problème de la communication dans les congrès et conférences, mais, en fait, elle déguise mal une évolution qui donne à l'anglais une suprématie incontestée. Il est manifeste pour tous que l'anglais tend au monopole dans les relations internationales. C'est la langue des agences de presse, des multinationales, de l'édition scientifique aussi bien que des chansons sur lesquelles, dans le monde entier, danse une jeunesse habillée à l'américaine.
La situation actuelle
Face à ce Goliath, l'espéranto est un David, petit au point d'être pratiquement invisible. Voyant les rivaux en présence, qui, raisonnablement, va parier pour lui? Comment miser sur une langue que ne soutient aucun vaste mouvement social, que les puissances d'argent ignorent, que les médias passent sous silence, que l'intelligentsia dénigre ou croit mort-née? Abondamment agressée tout au long de son histoire, tant sur le plan de la politique que des idées, elle n'a aucun allié, aucune aide extérieure. A une époque où l'image est reine, elle n'a pas les moyens de faire de la publicité. Elle n'a pour se propager que ses qualités intrinsèques.
Et cependant, si l'on se fonde sur des critères objectifs, comme la production de livres, la participation aux réunions internationales, l'aire géographique couverte par les petites annonces de la presse espérantophone, la quantité de manifestations, les émissions régulières à la radio, le nombre de localités où la langue de Zamenhof est représentée, etc., on s'aperçoit que, avec des hauts et des bas suivant les aléas de la vie politique et économique, l'espéranto n'a jamais cessé de se propager et que, depuis une dizaine d'années, en particulier, sa progression connaît une remarquable accélération.
Si, en 1976, 30 universités l'enseignaient, on en compte cette année 125, soit une multiplication par plus de 4 en 10 ans. L'espéranto sert de véhicule à une production littéraire considérable, qui va en se développant. C'est la langue du monde dans laquelle on traduit le plus de chansons. Il est parlé chaque jour à la radio dans des pays aussi différents que la Chine et la Pologne. Il est le moyen de communication quotidien de nombreux couples binationaux. Il est la langue maternelle d'un certain nombre d'enfants. Et l'étude objective du rapport efficacité/coût le révèle, dans la communication interculturelle, bien supérieur à l'anglais ou au recours à la traduction et à l'interprétation simultanée.
Si vous aviez tenu entre les mains la petite brochure de Zamenhof en 1887, auriez-vous imaginé qu'un peu moins d'un siècle plus tard, le congrès international le plus vaste de toute l'histoire de Chine se déroulerait à Pékin dans cette langue, dont le germe tout neuf se présentait à vos yeux? Auriez-vous parié à cette époque qu'en 1986 il ne se passerait pas un seul jour sans qu'il n'y ait quelque part dans le monde une conférence, un congrès, une rencontre internationale tenus en espéranto? Telle est pourtant la réalité.
Le rôle de l'affectivité individuelle
Ce décalage entre des paris sensés et la réalité vérifiable devrait nous interroger. En fait, tous ces jugements négatifs partent d'une même erreur: on néglige de vérifier la réalité, c'est-à-dire de déterminer comment l'espéranto fonctionne en pratique par comparaison avec les autres systèmes de communication en usage dans les situations interculturelles. En outre, on surestime les pressions extérieures et sous-estime le rôle de l'affectivité individuelle dans un processus de propagation et de vitalisation linguistiques.
Si la langue de Zamenhof manifeste une vitalité plus grande que certaines langues à statut officiel, comme le gaélique et le romanche, c'est parce que l'être humain aime créer, jouer, être libre et aimer.
Les structures de l'espéranto stimulent la créativité langagière, brimée chez chacun, dans les autres langues, depuis l'entrée à l'école. Elles donnent au langage une coloration ludique qui suscite le mépris des gens qui se prennent au sérieux, mais qui répond à une demande psychologique importante ancrée dans nos tréfonds. Par sa souplesse grammaticale, lexicale et stylistique, l'espéranto donne un sentiment de liberté dans l'expression qu'aucune langue ne confère au même degré, et ce, sans imposer de longues années d'étude. Et surtout, il permet de nouer des amitiés réelles et durables par-delà les frontières culturelles et répond ainsi à un besoin affectif plus profond qu'on ne le croit généralement.
Le fait est qu'en un siècle d'existence, l'espéranto a tissé sur toute la surface du globe d'innombrables réseaux d'amitiés entre personnes de toutes les couches sociales, de tous les milieux culturels. Sur ce terrain-là, il n'a pas de rival.
Il serait en droit de regarder de haut tous ceux qui, depuis un siècle, perdent leurs paris contre lui. Mais ce n'est pas son style. Il ne s'impose pas. Il lui suffit d'être, et de vivre. Disponible, pour ceux qui veulent jouer le jeu. Discret, voire invisible, pour ceux qui lui préfèrent des systèmes plus coûteux, plus injustes et plus compliqués. Tout juste attristé qu'on le prenne si souvent pour ce qu'il n'est pas et qu'on perçoive si mal encore tout ce qu'il peut apporter, dans les relations entre les peuples, non seulement à l'amitié et à la facilité, mais aussi à la justice et au respect de la dignité linguistique de chacun.
BULONJAPRELEGO
THE DEMAND TO be safe in relationship inevitably breeds sorrow and
fear. This seeking for security is inviting insecurity. Have you ever
found security in any of your relationships? Have you? Most of us want
the security of loving and being loved, but is there love when each one
of us is seeking his own security, his own particular path? We are not
loved because we don't know how to love.
What is
love? The word is so loaded and corrupted that I hardly like to use it.
Everybody talks of love - every magazine and newspaper and every
missionary talks everlastingly of love. I love my country, I love my
king, I love some book, I love that mountain, I love pleasure, I love
my wife, I love God. Is love an idea? If it is, it can be cultivated,
nourished, cherished, pushed around, twisted in any way you like. When
you say you love God what does it mean? It means that you love a
projection of your own imagination, a projection of yourself clothed in
certain forms of respectability according to what you think is noble
and holy; so to say, `I love God', is absolute nonsense. When you
worship God you are worshipping yourself - and that is not love.
Because we cannot solve this human thing called love we
run away into abstractions. Love may be the ultimate solution to all
man's difficulties, problems and travails, so how are we going to find
out what love is? By merely defining it? The church has defined it one
way, society another, and there are all sorts of deviations and
perversions. Adoring someone, sleeping with someone, the emotional
exchange, the companionship - is that what we mean by love? That has
been the norm, the pattern, and it has become so tremendously personal,
sensuous, and limited that religions have declared that love is
something much more than this. In what they call human love they see
there is pleasure, competition, jealousy, the desire to possess, to
hold, to control and to interfere with another's thinking, and knowing
the complexity of all this they say there must be another kind of love,
divine, beautiful, untouched, uncorrupted.
Throughout the world, so-called holy men have maintained that to look
at a woman is something totally wrong: they say you cannot come near to
God if you indulge in sex, therefore they push it aside although they
are eaten up with it. But by denying sexuality they put out their eyes
and cut out their tongues for they deny the whole beauty of the earth.
They have starved their hearts and minds; they are dehydrated human
beings; they have banished beauty because beauty is associated with
woman.
Can love be divided into the sacred and
the profane, the human and the divine, or is there only love? Is love
of the one and not of the many? If I say,`I love you', does that
exclude the love of the other? Is love personal or impersonal? Moral or
immoral? Family or non-family? If you love mankind can you love the
particular? Is love sentiment? Is love emotion? Is love pleasure and
desire? All these questions indicate, don't they, that we have ideas
about love, ideas about what it should or should not be, a pattern or a
code developed by the culture in which we live.
So to go into the question of what love is we must first ideals and
ideologies of what it should or should not be. To divide anything into
what should be and what is, is the most deceptive way of dealing with
life.
Now how am I going to find out what this
flame is which we call love - not how to express it to another but what
it means in itself? I will first reject what the church, what society,
what my parents and friends, what every person and every book has said
about it because I want to find out for myself what it is. Here is an
enormous problem that involves the whole of mankind, there have been a
thousand ways of defining it and I myself am caught in some pattern or
other according to what I like or enjoy at the moment - so shouldn't I,
in order to understand it, first free myself from my own inclinations
and prejudices? I am confused, torn by my own desires, so I say to
myself, `First clear up your own confusion. Perhaps you may be able to
discover what love is through what it is not.'
The government says, `Go and kill for the love of your country'. Is
that love? Religion says, `Give up sex for the love of God'. Is that
love? Is love desire? Don't say no. For most of us it is - desire with
pleasure, the pleasure that is derived through the senses, through
sexual attachment and fulfilment. I am not against sex, but see what is
involved in it. What sex gives you momentarily is the total abandonment
of yourself, then you are back again with your turmoil, so you want a
repetition over and over again of that state in which there is no
worry, no problem, no self. You say you love your wife. In that love is
involved sexual pleasure, the pleasure of having someone in the house
to look after your children, to cook. You depend on her; she has given
you her body, her emotions, her encouragement, a certain feeling of
security and well-being. Then she turns away from you; she gets bored
or goes off with someone else, and your whole emotional balance is
destroyed, and this disturbance, which you don't like, is called
jealousy. There is pain in it, anxiety, hate and violence. So what you
are really saying is, `As long as you belong to me I love you but the
moment you don't I begin to hate you. As long as I can rely on you to
satisfy my demands, sexual and otherwise, I love you, but the moment
you cease to supply what I want I don't like you.' So there is
antagonism between you, there is separation, and when you feel separate
from another there is no love. But if you can live with your wife
without thought creating all these contradictory states, these endless
quarrels in yourself, then perhaps - perhaps - you will know what love
is. Then you are completely free and so is she, whereas if you depend
on her for all your pleasure you are a slave to her. So when one loves
there must be freedom, not only from the other person but from oneself.
This belonging to another, being psychologically nourished
by another, depending on another - in all this there must always be
anxiety, fear, jealousy, guilt, and so long as there is fear there is
no love; a mind ridden with sorrow will never know what love is;
sentimentality and emotionalism have nothing whatsoever to do with
love. And so love is not to do with pleasure and desire.
Love is not the product of thought which is the past.
Thought cannot possibly cultivate love. Love is not hedged about and
caught in jealousy, for jealousy is of the past. Love is always active
present. It is not `I will love' or `I have loved'. If you know love
you will not follow anybody. Love does not obey. When you love there is
neither respect nor disrespect.
Don't you know
what it means really to love somebody - to love without hate, without
jealousy, without anger, without wanting to interfere with what he is
doing or thinking, without condemning, without comparing - don't you
know what it means? Where there is love is there comparison? When you
love someone with all your heart, with all your mind, with all your
body, with your entire being, is there comparison? When you totally
abandon yourself to that love there is not the other.
Does love have responsibility and duty, and will it use
those words? When you do something out of duty is there any love in it?
In duty there is no love. The structure of duty in which the human
being is caught is destroying him. So long as you are compelled to do
something because it is your duty you don't love what you are doing.
When there is love there is no duty and no responsibility.
Most parents unfortunately think they are responsible for
their children and their sense of responsibility takes the form of
telling them what they should do and what they should not do, what they
should become and what they should not become. The parents want their
children to have a secure position in society. What they call
responsibility is part of that respectability they worship; and it
seems to me that where there is respectability there is no order; they
are concerned only with becoming a perfect bourgeois. When they prepare
their children to fit into society they are perpetuating war, conflict
and brutality. Do you call that care and love?
Really to care is to care as you would for a tree or a plant, watering
it, studying its needs, the best soil for it, looking after it with
gentleness and tenderness - but when you prepare your children to fit
into society you are preparing them to be killed. If you loved your
children you would have no war.
When you lose
someone you love you shed tears - are your tears for yourself or for
the one who is dead? Are you crying for yourself or for another? Have
you ever cried for another? Have you ever cried for your son who is
killed on the battlefield? You have cried, but do those tears come out
of self-pity or have you cried because a human being has been killed?
If you cry out of self-pity your tears have no meaning because you are
concerned about yourself. If you are crying because you are bereft of
one in whom you have invested a great deal of affection, it was not
really affection. When you cry for your brother who dies cry for him.
It is very easy to cry for yourself because he is gone. Apparently you
are crying because your heart is touched, but it is not touched for
him, it is only touched by self-pity and self-pity makes you hard,
encloses you, makes you dull and stupid.
When
you cry for yourself, is it love - crying because you are lonely,
because you have been left, because you are no longer powerful -
complaining of your lot, your environment - always you in tears? If you
understand this, which means to come in contact with it as directly as
you would touch a tree or a pillar or a hand, then you will see that
sorrow is self-created, sorrow is created by thought, sorrow is the
outcome of time. I had my brother three years ago, now he is dead, now
I am lonely, aching, there is no one to whom I can look for comfort or
companionship, and it brings tears to my eyes.
You can see all this happening inside yourself if you watch it. You can
see it fully, completely, in one glance, not take analytical time over
it. You can see in a moment the whole structure and nature of this
shoddy little thing called `me', my tears, my family, my nation, my
belief, my religion - all that ugliness, it is all inside you. When you
see it with your heart, not with your mind, when you see it from the
very bottom of your heart, then you have the key that will end sorrow.
Sorrow and love cannot go together, but in the Christian world they
have idealized suffering, put it on a cross and worshipped it, implying
that you can never escape from suffering except through that one
particular door, and this is the whole structure of an exploiting
religious society.
So when you ask what love is,
you may be too frightened to see the answer. It may mean complete
upheaval; it may break up the family; you may discover that you do not
love your wife or husband or children - do you? - you may have to
shatter the house you have built, you may never go back to the temple.
But if you still want to find out, you will see that fear
is not love, dependence is not love, jealousy is not love,
possessiveness and domination are not love, responsibility and duty are
not love, self-pity is not love, the agony of not being loved is not
love, love is not the opposite of hate any more than humility is the
opposite of vanity. So if you can eliminate all these, not by forcing
them but by washing them away as the rain washes the dust of many days
from a leaf, then perhaps you will come upon this strange flower which
man always hungers after.
If you have not got
love - not just in little drops but in abundance - if you are not
filled with it - the world will go to disaster. You know intellectually
that the unity of mankind is essential and that love is the only way,
but who is going to teach you how to love? Will any authority, any
method, any system, tell you how to love? If anyone tells you, it is
not love. Can you say, `I will practise love. I will sit down day after
day and think about it. I will practise being kind and gentle and force
myself to pay attention to others?' Do you mean to say that you can
discipline yourself to love, exercise the will to love? When you
exercise discipline and will to love, love goes out of the window. By
practising some method or system of loving you may become
extraordinarily clever or more kindly or get into a state of
non-violence, but that has nothing whatsoever to do with love.
In this torn desert world there is no love because
pleasure and desire play the greatest roles, yet without love your
daily life has no meaning. And you cannot have love if there is no
beauty. Beauty is not something you see - not a beautiful tree, a
beautiful picture, a beautiful building or a beautiful woman. There is
beauty only when your heart and mind know what love is. Without love
and that sense of beauty there is no virtue, and you know very well
that, do what you will, improve society, feed the poor, you will only
be creating more mischief, for without love there is only ugliness and
poverty in your own heart and mind. But when there is love and beauty,
whatever you do is right, whatever you do is in order. If you know how
to love, then you can do what you like because it will solve all other
problems.
So we reach the point: can the mind
come upon love without discipline, without thought, without
enforcement, without any book, any teacher or leader - come upon it as
one comes upon a lovely sunset?
It seems to me
that one thing is absolutely necessary and that is passion without
motive - passion that is not the result of some commitment or
attachment, passion that is not lust. A man who does not know what
passion is will never know love because love can come into being only
when there is total self-abandonment.
A mind
that is seeking is not a passionate mind and to come upon love without
seeking it is the only way to find it - to come upon it unknowingly and
not as the result of any effort or experience. Such a love, you will
find, is not of time; such a love is both personal and impersonal, is
both the one and the many. Like a flower that has perfume you can smell
it or pass it by. That flower is for everybody and for the one who
takes trouble to breathe it deeply and look at it with delight. Whether
one is very near in the garden, or very far away, it is the same to the
flower because it is full of that perfume and therefore it is sharing
with everybody.
Love is something that is new,
fresh, alive. It has no yesterday and no tomorrow. It is beyond the
turmoil of thought. It is only the innocent mind which knows what love
is, and the innocent mind can live in the world which is not innocent.
To find this extraordinary thing which man has sought endlessly through
sacrifice, through worship, through relationship, through sex, through
every form of pleasure and pain, is only possible when thought comes to
understand itself and comes naturally to an end. Then love has no
opposite, then love has no conflict.
You may
ask, `If I find such a love, what happens to my wife, my children, my
family? They must have security.' When you put such a question you have
never been outside the field of thought, the field of consciousness.
When once you have been outside that field you will never ask such a
question because then you will know what love is in which there is no
thought and therefore no time. You may read this mesmerized and
enchanted, but actually to go beyond thought and time - which means
going beyond sorrow - is to be aware that there is a different
dimension called love.
But you don't know how to
come to this extraordinary fount - so what do you do? If you don't know
what to do, you do nothing, don't you? Absolutely nothing. Then
inwardly you are completely silent. Do you understand what that means?
It means that you are not seeking, not wanting, not pursuing; there is
no centre at all. Then there is love.

Si l'on perd le contact avec la nature, on perd le contact avec l'humanité. Coupé de tout rapport avec la nature, on devient un tueur. On peut alors massacrer des bébés phoques, des baleines, des dauphins et des hommes, pour le profit, le "sport", pour sa nourriture ou au nom de la science. La nature se sent alors menacée par vous et vous prive de sa beautée. Vous pourrez effectuer de longues promenades dans les bois ou camper dans des endroits merveilleux, vous resterez un tueur et tout rapport d'amitié avec ces lieux vous sera refusé. Vous n'êtes probablement proche de rien ni de quiconque, qu'il s'agisse de votre femme ou de votre mari. Vous êtes bien trop occupé, pris dans la course des profits et des pertes et dans le cycle de votre propre pensée, de vos plaisirs et de vos douleurs. Vous vivez dans les trénèbres de votre propre isolement et vouloir le fuir vous plonge dans des ténèbres encore plus profondes. Vous ne vous préoccupez que d'une survie à court terme, irréfléchie, que vous soyez accomodant ou violent. Et des milliers d'êtres meurent de faim ou sont massacrés à cause de votre irresponsabilité. Vous abandonnez la marche de ce monde aux politiciens corrompus et menteurs, aux intellectuels, aux spécialistes. Etant vous -mêmes dépourvu d'intégrité, vous édifiez une société immorale, malhonnête, qui repose sur l'égoïsme absolu. Et quand vous tentez de fuir cet univers dont vous êtes seul responsable, c'est pour aller sur les plages, dans les bois ou faire du "sport" avec un fusil.
Il est possible que vous sachiez tout cela, mais cette connaissance ne peut nullement vous transformer. Ce n'est qu'en éprouvant le sentiment de faire partie intégrante du tout que vous serez relié à l'univers.

La tempête qu’a déchaînée en Israël le concert donné le 7 juillet 2001 par le remarquable pianiste et chef d’orchestre Daniel Barenboïm, au cours duquel il a joué un extrait orchestral d’un opéra de Richard Wagner, mérite toute notre attention. Cet ami proche, dois-je préciser d’emblée, fait depuis l’objet d’un déluge de critiques, d’insultes et de remontrances outrées. Cela parce que Richard Wagner (1813-1883) était à la fois un très grand compositeur et un antisémite notoire (à ce titre, profondément répugnant). Et parce que, bien après sa mort, il fut le musicien favori de Hitler, si bien qu’on l’a communément associé, non sans raison, au régime nazi et au terrible sort des millions de juifs et autres peuples « inférieurs » exterminés par ce régime.
Si elle passe parfois à la radio et qu’on en trouve des enregistrements en vente dans le pays, la musique de Wagner est, de fait, interdite de représentation publique en Israël. Pour de nombreux juifs israéliens, cette musique, riche, extraordinairement complexe et qui a énormément influencé l’univers musical, en est venue en quelque sorte à symboliser les horreurs de l’antisémitisme allemand.
Précisons que de nombreux Européens non juifs rejettent Wagner pour des raisons semblables, notamment dans les pays ayant subi l’occupation nazie pendant la seconde guerre mondiale. Le caractère grandiloquent, « germanique » (un adjectif abusivement employé) et si impérieux de son oeuvre, composée exclusivement d’opéras, son attachement au passé, aux mythes, aux traditions et aux accomplissements germaniques, sa prose infatigable, verbeuse et pompeuse sur les races inférieures et les héros sublimes (et germaniques), font de Wagner un personnage difficile à accepter, et encore plus à aimer ou à admirer.
Reste qu’il fut incontestablement un grand génie, s’agissant de théâtre et de musique. Il a révolutionné toute notre conception de l’opéra, entièrement transformé le système tonal et créé dix chefs-d’oeuvre, dix opéras qui figurent au pinacle de la musique occidentale. Le défi qu’il lance, non seulement aux juifs israéliens mais à tous, est le suivant : comment admirer et interpréter sa musique tout en la dissociant de ses écrits odieux et de leur utilisation par les nazis.
Comme Daniel Barenboïm l’a souvent souligné, aucun des opéras de Wagner ne comporte d’éléments directement antisémites. Pour le dire plus crûment, si Wagner exprimait sa haine des juifs dans ses pamphlets, on ne les retrouve pas du tout dans son oeuvre musicale en tant que juifs ou que personnages juifs. De nombreux critiques ont décelé des relents d’antisémitisme dans certains personnages que Wagner traite avec mépris et dérision dans ses opéras ; mais, il s’agit là d’imputations et non de preuves d’antisémitisme. Si la ressemblance est indéniable entre Beckmesser, personnage dérisoire des Maîtres chanteurs, le seul opéra-comique de Wagner, et les caricatures qu’on faisait communément des juifs à l’époque, il n’en demeure pas moins que Beckmesser représente un chrétien allemand dans cet opéra et certainement pas un juif. Wagner, dans son esprit, opérait une distinction entre les juifs dans la réalité et les juifs dans sa musique : prolixe dans ses écrits, il garde le silence à leur sujet dans son oeuvre musicale.
Savoir passer outre aux convenances
Quoi qu’il en soit, les oeuvres de Wagner n’avaient jamais été jouées en Israël avant le 7 juillet 2001 du fait d’un consensus. Outre le Chicago Symphony Orchestra, Daniel Barenboïm dirige le Berliner Staatoper, qui donnait trois concerts consécutifs à Jérusalem. Il avait initialement programmé le 7 juillet une représentation du premier acte de l’opéra La Walkyrie. A la demande du directeur du Festival d’Israël, qui les avait invités en premier lieu, lui et l’orchestre allemand, Daniel Barenboïm avait remplacé cet acte par des oeuvres de Schumann et de Stravinsky. A la fin du concert, Barenboïm proposa au public de jouer en bis un court extrait de Tristan et Isolde. Il ouvrit un débat contradictoire dans l’assistance et annonça, à la fin, qu’il jouerait le morceau, suggérant à ceux que cela choquait de quitter la salle, ce que firent certains. L’oeuvre de Wagner fut bien accueillie par un auditoire ravi de 2 800 Israéliens et, j’en suis sûr, extrêmement bien interprétée.
Et pourtant, les attaques contre Barenboïm n’ont pas cessé depuis. La presse rapportait le 25 juillet 2001 que la commission de la Knesset chargée de la culture et de l’éducation « appelait les organismes culturels d’Israël à boycotter le chef d’orchestre (...) pour avoir joué la musique du compositeur préféré de Hitler lors de la manifestation culturelle la plus importante d’Israël, tant qu’il n’aura pas présenté ses excuses ». Le musicien, qui s’est toujours considéré comme israélien malgré sa petite enfance passée en Argentine, a fait l’objet d’attaques fielleuses de la part du ministère de la culture et d’autres sommités.
Il a grandi en Israël, fréquenté l’école hébraïque et possède un passeport israélien en plus de son passeport argentin. Figure centrale de la vie musicale du pays pendant des années, il a toujours été considéré comme un grand atout culturel d’Israël même si, depuis la fin de son adolescence, il a vécu la plupart du temps en Europe et aux Etats-Unis. Ces circonstances tiennent à des raisons professionnelles : c’est ailleurs qu’en Israël, le plus souvent, que se sont présentées à lui des perspectives importantes. Qu’il ait dirigé et joué à Berlin, Paris, Londres, Vienne, Salzbourg, Bayreuth, New York, Chicago, Buenos Aires et ailleurs, a toujours éclipsé le fait qu’il pouvait résider dans un endroit précis. Dans une certaine mesure, comme nous le verrons, cette vie cosmopolite, voire iconoclaste, est une des causes des foudres qui s’abattent sur lui depuis l’incident Wagner.
Le personnage ne manque toutefois pas de complexité, ce qui explique aussi la tempête qu’il a suscitée. Toutes les sociétés se composent majoritairement de citoyens moyens - de gens qui suivent des voies toutes tracées - et d’un petit nombre qui, en vertu de leurs talents et d’une inclination à l’indépendance, ne sont pas du tout moyens et mettent en question la majorité ordinairement docile, voire lui font injure. Les problèmes surviennent lorsque cette majorité docile tente, dans sa vision des choses, de réduire, de simplifier et de codifier les gens complexes, qui n’agissent pas par routine et qui forment une minuscule minorité. Le heurt est immanquable - les êtres humains rassemblés en grand nombre ont du mal à tolérer quelqu’un de manifestement différent, de plus doué et de plus original qu’eux - et suscite immanquablement colère et irrationalité au sein de la majorité. Voyez ce qu’Athènes a fait à Socrate, coupable d’être un génie qui enseignait à la jeunesse comment penser par elle-même et savoir douter : elle l’a condamné à mort. Les juifs d’Amsterdam ont excommunié Spinoza, dont les idées les dépassaient. Galilée a subi le châtiment de l’Eglise. Ses pensées visionnaires ont valu à Al-Hallaj (1) d’être crucifié. Il en va ainsi depuis des siècles. Barenboïm est un personnage talentueux, tout à fait hors du commun, qui a franchi trop de lignes rouges et trop violé des tabous qui ligotent la société israélienne. Cela mérite ici quelques détails.
Inutile de rappeler que, musicalement parlant, Barenboïm est exceptionnel. Il dispose de tous les dons possibles et imaginables qui font un grand soliste et un grand chef d’orchestre - une mémoire parfaite, une compétence et même une intelligence technique remarquables, la capacité de s’attacher le public et, surtout, un immense amour pour ce qu’il fait. Rien de ce qui touche à la musique n’est hors de sa portée ou trop difficile. Il démontre dans tout ce qu’il fait une maîtrise apparemment sans effort - talent que lui reconnaissent tous les musiciens en vie aujourd’hui.
Mais les choses ne sont pas si simples. Ayant passé les premières années de sa vie d’abord en Argentine, où l’on parle espagnol, puis en Israël, où l’on parle hébreu, il possède les deux nationalités sans en posséder vraiment aucune. A la fin de son adolescence, il n’a pas véritablement vécu en Israël, préférant l’atmosphère cosmopolite et culturelle des Etats-Unis et de l’Europe, où il occupe aujourd’hui deux postes parmi les plus prestigieux du monde musical : chef de ce qui représente sans doute le meilleur orchestre américain et directeur de l’une des plus anciennes et admirables compagnies du monde. Et ce, tout en poursuivant sa carrière de pianiste. S’il a pu mener ce genre de vie itinérante et voir ses mérites à ce point reconnus, ce n’est évidemment pas en se pliant assidûment aux normes des gens ordinaires mais, bien au contraire, en sachant passer outre aux convenances et ignorer les barrières.
Cela est vrai de toute personne hors du commun, qui a besoin de vivre bien au-delà des bienséances de la société bourgeoise. Peu de réalisations artistiques et scientifiques importantes voient le jour lorsque l’on vit dans le cadre étroit censé réguler la vie sociale et politique.
Les choses se compliquent encore. Sa vie est si riche et il voyage tellement, sans compter ses dons linguistiques (il parle sept langues couramment), que Barenboïm, dans un sens, est chez lui partout et nulle part. Ce qui veut dire qu’il ne séjourne en Israël que quelques jours par an, tout en demeurant en contact par téléphone et par la presse. Et il n’a pas vécu qu’aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne, où il passe actuellement la plus grande partie de son temps.
On peut imaginer que, pour de nombreux juifs aux yeux desquels l’Allemagne représente encore la quintessence du mal et de l’antisémitisme, la pilule soit dure à avaler, d’autant que sa musique de prédilection comme interprète appartient au répertoire austro-allemand classique, dont les opéras de Wagner constituent le coeur. (En cela, il marche sur les pas de Wilhelm Furtwangler, le plus grand chef d’orchestre allemand du XXe siècle, une autre figure politique d’une grande complexité.)
Fasciné par l’Autre
D’un point de vue esthétique, pour un musicien classique, il s’agit d’un bon choix, et même d’un choix inévitable : il se concentre sur les oeuvres majeures de Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, Schumann, Bruckner, Mahler, Wagner, Richard Strauss, sans compter, bien sûr, de nombreux autres compositeurs des répertoires français, russe et espagnol dans lesquels il excelle. Mais la musique autrichienne et allemande demeure le centre du répertoire, une musique qui a parfois posé un gros problème à certains philosophes et artistes juifs, surtout après la seconde guerre mondiale. Arthur Rubinstein, le grand pianiste, ami et mentor de Barenboïm, avait plus ou moins dit qu’il n’irait jamais jouer en Allemagne car, avait-il expliqué, en tant que juif, il lui était difficile de séjourner dans un pays qui avait massacré tant des siens. Déjà, le fait que Barenboïm habite Berlin, au coeur de l’ancienne capitale du IIIeReich, dont de nombreux juifs considèrent qu’elle porte encore aujourd’hui les stigmates de l’ancien mal, a donc jeté le trouble dans l’esprit de beaucoup de ses admirateurs israéliens.
Dire en parlant des artistes qu’il faut faire preuve d’ouverture d’esprit, que l’art est une chose et la politique une autre, est en fait une absurdité que dément précisément le cas de la plupart des artistes et des musiciens que nous admirons le plus. Tous les grands compositeurs se sont intéressés à la politique d’une manière ou d’une autre et ont défendu des idées politiques fortes, certaines paraissant aujourd’hui peu défendables, comme l’adulation que le jeune Beethoven portait à Napoléon, en qui il voyait un grand conquérant, ou l’adhésion de Debussy à la droite nationaliste française. Haydn, pour prendre un autre exemple, fut l’employé servile de son aristocrate de mécène, le prince Esterhazy ; jusqu’au plus grand de tous les génies, Jean-Sébastien Bach, qui avait toujours sa place de flagorneur à la table d’un archevêque ou à la cour d’un duc.
Nous n’accordons pas beaucoup d’importance à ces réalités, car elles appartiennent à un passé relativement lointain. Aucune ne nous choque autant qu’un des pamphlets racistes de Thomas Carlyle publiés dans les années 1860 (2). Mais deux autres facteurs sont aussi à prendre en considération. D’abord, la musique est une forme artistique différente du langage : les notes n’ont pas de sens stable, à la différence de mots comme « chat » ou « cheval ». Ensuite, la musique est en majeure partie transnationale ; elle transcende les frontières d’un pays, d’une nationalité et d’une langue. Pour apprécier Mozart, vous n’avez pas besoin de connaître l’allemand, pas plus que d’être français pour lire une partition de Berlioz. Vous devez connaître la musique : cette technique très spécialisée, qui s’acquiert au prix d’une laborieuse attention, n’a pas grand rapport avec des sujets comme l’histoire et la littérature, bien qu’à mon avis il faille connaître le contexte et les traditions dans lesquels s’inscrit une oeuvre musicale pour pouvoir véritablement la comprendre et l’interpréter. D’une certaine manière, la musique ressemble à l’algèbre, mais pas tout à fait cependant, comme le prouve le cas de Wagner.
Se fût-il agi d’un compositeur mineur ou d’un musicien composant ses oeuvres en milieu clos ou du moins sans faire de vagues, les contradictions de Wagner eussent été d’une certaine façon plus faciles à accepter et à tolérer. Mais Wagner était incroyablement loquace : ses déclarations, ses projets, sa musique emplissaient l’Europe, déferlant dans un même flot, toujours démesurés, cherchant à submerger le public comme aucun autre musicien. Au centre de toutes ses oeuvres, il trône, extraordinairement égocentrique, narcissique même, son ego incarnant à ses yeux l’essence de l’âme allemande, son destin et ses privilèges.
Je ne peux évidemment pas discuter ici de l’oeuvre de Wagner, mais il me paraît important de souligner que le musicien recherchait la polémique, l’attention. Sa propre cause, qui se confondait avec celle de l’Allemagne et qu’il concevait dans les termes révolutionnaires les plus extrêmes, il la servait dans toutes ses oeuvres. Sa musique allait être une musique nouvelle, un art nouveau, une esthétique nouvelle ; elle allait incarner la tradition de Beethoven et de Goethe et les transcender dans une nouvelle synthèse universelle. Personne, dans l’histoire de l’art, n’a attiré l’attention comme Wagner l’a fait, ni suscité autant d’écrits et de commentaires.
Si les nazis pouvaient se l’approprier, n’oublions pas que d’autres musiciens ont vu en Wagner un héros et un grand génie et compris que ses accomplissements allaient changer le cours de la musique occidentale. De son vivant, il possédait un opéra particulier, un sanctuaire presque, qu’il avait fait construire pour y donner ses opéras dans la petite ville de Bayreuth, où se déroule toujours un festival annuel exclusivement consacré à ses oeuvres. Bayreuth et la famille Wagner étaient chers à Hitler et, pour compliquer encore les choses, le petit-fils de Richard Wagner, Wolfgang, dirige encore le festival d’été où Barenboïm se produit régulièrement depuis deux décennies.
Mais, ce n’est pas tout. Barenboïm est un artiste qui renverse les obstacles, franchit les lignes interdites et pénètre en territoire tabou. Sans pour cela se poser en personnalité politique, il n’a pas caché son opposition à l’occupation des territoires palestiniens par Israël et a été le premier Israélien, début 1999, à proposer de donner un concert gratuit à l’université de Bir Zeit, en Cisjordanie. Ces trois dernières années (les deux premières à Weimar et la dernière à Chicago), il a rassemblé de jeunes musiciens israéliens et arabes afin qu’ils jouent ensemble - une entreprise audacieuse qui tente de dépasser la politique et le conflit et de créer une alliance dans l’art non politique de l’interprétation musicale.
Il est fasciné par l’Autre et rejette catégoriquement l’irrationalité inhérente à l’attitude consistant à dire qu’il vaut mieux ne pas connaître que connaître. Je pense comme lui que l’ignorance ne saurait être une bonne stratégie politique pour un peuple et que, par conséquent, chacun à sa façon doit comprendre et connaître l’Autre même s’il y a un interdit. Peu de personnes pensent ainsi mais, à mes yeux, et de plus en plus de gens me rejoignent, c’est la seule position qui soit intellectuellement cohérente. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille relâcher sa défense de la justice ni sa solidarité avec les opprimés, abandonner son identité ou se détourner de la réalité politique. Cela signifie qu’être un citoyen passe par la raison, la compréhension et l’analyse intellectuelle et non par l’organisation et l’encouragement de passions collectives comme celles qui semblent s’emparer des intégristes. Je défends ces idées depuis longtemps et peut-être est-ce pour cela que Barenboïm et moi-même sommes restés amis malgré nos divergences.
Apprendre à penser par soi-même
Le rejet total, la condamnation purement irraisonnée, la dénonciation globale d’un phénomène aussi complexe que Wagner est une chose irrationnelle et au fond inacceptable ; tout comme est stupide et contre-productive, de notre côté arabe, la politique consistant depuis des années à employer des expressions comme l’« entité sioniste » et à refuser complètement de comprendre et d’analyser Israël et les Israéliens sous prétexte qu’on ne peut reconnaître leur existence, car ils ont causé la nakba (la catastrophe) palestinienne. L’histoire a sa dynamique, et si nous ne voulons pas que les juifs israéliens invoquent l’Holocauste pour justifier les abominables violations des droits de la personne qu’ils commettent à l’encontre du peuple palestinien, nous devons, nous aussi, dépasser l’idiotie consistant à dire que l’Holocauste n’a jamais eu lieu et que les Israéliens, hommes, femmes et enfants, sont voués à notre hostilité éternelle.
Rien dans l’histoire qui soit figé dans le temps ; rien dans l’histoire qui échappe au changement ; rien dans l’histoire qui soit au-delà de la raison, de la compréhension, de l’analyse et de l’influence. Les politiques et les démagogues professionnels peuvent dire toutes les bêtises qu’ils veulent et faire comme il leur plaît. Mais chez les intellectuels, les artistes et les citoyens libres, il faut toujours qu’il y ait de la place pour la différence d’opinion, les idées autres, les moyens de mettre en question la tyrannie de la majorité et, en même temps, ce qui est plus important encore, de faire avancer la liberté et les lumières humaines.
On peut difficilement écarter cette idée comme étant d’origine « occidentale » et ne pouvant donc s’appliquer ni Arabes ni aux musulmans, pas plus qu’aux sociétés et aux traditions juives. Il s’agit d’une valeur universelle que l’on trouve, à ma connaissance, dans toutes les traditions. Dans toutes les sociétés, des conflits opposent justice et injustice, savoir et ignorance, liberté et oppression. Il ne s’agit pas de prendre tel ou tel parti parce qu’on nous dit de le faire, mais de choisir scrupuleusement et d’arriver à des jugements qui prennent en compte tous les aspects de la situation. Le but de l’éducation n’est pas d’accumuler des faits ni de mémoriser la « bonne » réponse, mais d’apprendre à penser de manière critique par soi-même et à comprendre la signification des choses par soi-même.
Dans le cas de Wagner et de Barenboïm, la solution de facilité consisterait à cataloguer le chef d’orchestre comme un opportuniste ou un aventurier indifférent. Il est tout aussi réducteur de dire de Wagner qu’il était un être effroyable aux idées réactionnaires et que, par conséquent, sa musique, aussi merveilleuse soit-elle, est intolérable car infestée du même poison que sa prose. Et comment pourrait-on le prouver ? Combien resterait-il d’écrivains, de musiciens, de poètes, de peintres si l’on jugeait leur art à l’aune de leur attitude morale ? Et qui déciderait du seuil de laideur et de turpitude acceptable dans la production artistique d’un artiste ?
Une fois que l’on commence à censurer, il n’y a pas de limite théorique. Je pense au contraire qu’il incombe à l’esprit de pouvoir analyser un phénomène complexe comme la question de Wagner en Israël (ou, pour prendre un autre exemple, exposé dans un célèbre essai par le brillant romancier nigérian Chinua Achebe, la question de comment lire Au coeur des ténèbres, de Joseph Conrad, pour un Africain d’aujourd’hui) et de faire la part du mal et de l’art.
Un esprit mûr devrait pouvoir appréhender ensemble deux faits contradictoires : un, que Wagner était un grand artiste, et deux, que Wagner était un être humain odieux. Malheureusement, un fait ne va pas sans l’autre. Cela signifie-t-il qu’il ne faille pas écouter Wagner ? Pas du tout, même s’il va de soi qu’il n’est nul besoin d’infliger sa musique à ceux que trouble encore l’association entre Wagner et l’Holocauste. Je soulignerais cependant qu’il est nécessaire de faire preuve d’ouverture vis-à-vis de l’art. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas juger moralement les artistes coupables de pratiques immorales et funestes, mais que l’oeuvre d’un artiste ne peut être jugée et condamnée uniquement sur cette base.
Notons un dernier point et une autre analogie avec la situation arabe. Pendant le débat passionné de l’an dernier à la Knesset sur la question de savoir si les élèves du secondaire devaient ou non pouvoir choisir de lire Mahmoud Darwish, nombre d’entre nous ont vu dans la violence avec laquelle l’idée a été attaquée le signe de l’étroitesse d’esprit du sionisme orthodoxe. Déplorant qu’on puisse s’opposer à l’idée que de jeunes Israéliens profitent de la lecture d’un grand auteur palestinien, beaucoup de gens ont fait valoir qu’on ne pouvait pas éternellement cacher l’histoire et la réalité et qu’une telle censure n’avait pas sa place dans les programmes scolaires.
La musique de Wagner pose un problème similaire, bien que l’association de sa musique et de ses idées à des faits terribles représente indéniablement un véritable traumatisme pour ceux qui pensent que les nazis se sont approprié un compositeur fait sur mesure. Mais, s’agissant d’un artiste de l’envergure de Wagner, il n’était pas possible d’en ignorer éternellement l’existence. Si Barenboïm n’avait pas joué sa musique en Israël le 7 juillet 2001, quelqu’un d’autre l’aurait fait tôt ou tard. Une réalité complexe finit toujours par s’échapper des scellés. Il s’agit alors de comprendre le phénomène Wagner et non d’en reconnaître ou non l’existence.
Dans le contexte arabe, la campagne contre la « normalisation » avec Israël, contre tout contact avec la société israélienne, un problème urgent, d’une tout autre actualité - Israël se livre à des formes de punition collective et de meurtres quotidiens contre tout un peuple dont elle occupe le territoire illégalement depuis trente-quatre ans - n’est pas sans rappeler les tabous israéliens qui frappent la poésie palestinienne et Wagner. Le problème vient de ce que les gouvernements arabes entretiennent des relations économiques et politiques avec Israël tandis que certains groupes tentent d’interdire tout contact avec les Israéliens. Interdire la normalisation manque de cohérence puisque l’oppression du peuple palestinien par Israël, raison d’être de cet interdit, n’a pas diminué du fait de cette campagne : combien de foyers palestiniens ont échappé à la démolition grâce aux mesures antinormalisation, et combien d’universités palestiniennes ont été en mesure de dispenser un enseignement à leurs étudiants grâce à l’antinormalisation ? Aucune, hélas ! et c’est pourquoi j’ai dit qu’il valait mieux, pour un intellectuel égyptien distingué, venir en Palestine par solidarité, y enseigner, donner une conférence ou offrir une aide médicale, que de rester chez lui et d’empêcher les autres de le faire. L’antinormalisation intégrale n’est pas une arme efficace aux mains de ceux qui sont privés de pouvoir : sa valeur symbolique est faible, et son effet réel n’est que passif et négatif.
Pour être efficaces, les armes des faibles - comme en Inde, en Amérique du Sud, au Vietnam, en Malaisie et ailleurs - sont toujours actives, et même agressives. Il s’agit de placer l’oppresseur puissant dans une position d’inconfort et de vulnérabilité, à la fois moralement et politiquement. Les attentats-suicides ne produisent pas cet effet, pas plus que l’antinormalisation qui, dans le cas de la lutte de libération en Afrique du Sud, a pris la forme d’un dispositif comprenant le boycott des universitaires étrangers.
Voilà pourquoi j’estime que nous devons tenter de pénétrer la
conscience israélienne par tous les moyens dont nous disposons.
S’adresser ou écrire à des auditoires israéliens brise leur tabou à
notre encontre. La peur d’être interpellé justement dans ce que leur
mémoire collective a supprimé est précisément à l’origine du débat sur
la littérature palestinienne. Le sionisme a tenté d’exclure les
non-juifs ; et nous, en boycottant indifféremment jusqu’au nom même d’«
Israël », nous l’avons en fait aidé plutôt qu’arrêté. Dans un contexte
différent, c’est pourquoi l’interprétation par Barenboïm d’un morceau
de Wagner, si elle a profondément blessé de nombreuses personnes
souffrant encore des traumatismes du génocide antisémite, a eu pour
effet salutaire de permettre au deuil de franchir une étape, celle de
la vie elle-même, qu’il faut vivre, qui doit continuer et qu’on ne peut
figer dans le passé. Peut-être n’ai-je pas abordé toutes les nuances de
cette problématique complexe, mais la chose essentielle à souligner est
que la vie ne peut être gouvernée par des tabous et des interdits
frappant l’esprit critique et l’expérience libératrice. Ces
dispositions méritent toujours qu’on leur accorde la plus grande
priorité. Ne pas savoir et ne pas vouloir savoir, ce n’est pas ce qui
nous ouvrira la voie du présent.
Edward W. Said.